A 21 ans, Amélie était mère d’un petit garçon et veuve d’un héros moderne, tombé au champ d’honneur de la circulation routière. Cette disparition avait brisé l’harmonie d’une vie organisée autour du sexe, le membre viril, le sperme, le plaisir physique, le tout faisant un ensemble indissociable avec, aboutissement ultime, les enfants à naître. Amélie voulait une famille nombreuse et l’avait montré en commençant très tôt.
Le membre viril, Amélie en ornait les lettres qu’elle adressait à son mari et recevait en retour l’équivalent féminin. Plus encore que toute autre, elle était fascinée par le sperme, ce mystère jaillissant qu’elle adulait pour son pouvoir reproducteur. En toute logique, elle ne le voulait que dans « son vase naturel », comme dit le pape et, plus que tout autre, elle s’extasiait de recevoir ce jet chaud dans son intimité. Beaucoup de femmes s’en réjouissent et trouvent le mot pour le faire savoir. Pour Amélie, c’était une part intégrale de sa jouissance. Plus tard me le réclamera avec insistance, faisant fi de toute contrainte physiologique. Quel contraste avec cette amie qui ne résistait pas au plaisir de tomber à mes genoux, y compris dans les circonstances des plus scabreuses, mais n’acceptait qu’avec réticence de « se faire sauter ». De même Amélie considérait avec quelque dégout son amie Béatrice qui ne refusait pas une petite gâterie à tout garçon qui le lui demandait gentiment et, au resto U (universitaire), terminait invariablement son repas par une banane. Quand elle la portait à la bouche, toute la table s’esclaffait joyeusement. Béa recevait avec le sourire ce qu’elle considérait comme un hommage. Les filles ne semblaient pas en prendre ombrage. Sans doute n’y voyaient-elles qu’un acte hygiénique, ce qui est un peu vrai. Par contre pour Amélie il n’y avait de plaisir qu’en ses cuisses, et nulle part ailleurs, là où elle ressentait douloureusement son veuvage. Elle l’avait dit aux copines, elle n’en pouvait plus de ne pas baiser. Les garçons, eux, en étaient directement informés ; elle ne manquait pas de frotter son pubis à toute braguette qui passait à sa portée. Dominique s’en était indignée « Ma parole, elle les veut tous, celle-là ? ». Dominique veillait à l’équilibre et l’harmonie du groupe et devait rester vigilante face à pareil trublion.
J’étais à ce moment-là, relativement, disponible et je sentais bien peser sur moi la responsabilité de régler le problème Amélie. Un jour Dominique, serrée à moi, écourta son délicieux baiser – vous ai-je dit que Dominique avait les plus délicieux des baisers ? Avait-elle Feydeau en tête quand elle m’intima : Occupe-toi d’Amélie ! Qu’avais-je à faire d’Amélie ? J’avais dans mes bras la plus belle, la plus douce des femmes, ses merveilleux seins contre ma poitrine, son grand front appuyé au mien, je respirais un souffle qui m’enivrait ; ses épaules délicieusement arrondies blotties sous mon bras, ma main errait dans sa longue chevelure blonde.
Pourtant, vérité bien établie, on ne refuse rien à une jolie femme. Me voici donc un soir à la porte d’Amélie. A n’en pas douter, l’accomplissement du devoir qui m’incombait ne serait pas trop pénible, cependant l’intimité de cette petite chambre me troubla. Ce lieu spartiate et laid me parut bizarrement une promesse de plaisir. Hélas, mon exaltation fit rapidement place à une sourde crainte en réalisant que je m’étais assis machinalement sur un lit d’appoint, chose rare dans une chambre d’étudiant. Pire, le lit pouvait s’isoler de la pièce par une cloison mobile. Le sombre présage se réalisa dans son intégralité. Après m’avoir embrassé fraternellement sur les deux joues, Amélie tira tranquillement la cloison avant de regagner son lit.
Me voici muré dans un placard, seul sur un mauvais matelas ! Que suis-je venu faire dans cette galère ? Rien ne m’empêche de fuir, bien sûr, mais reprendre la route, seul dans la nuit, quelle déroute et quelle déconvenue. Je sais d’expérience qu’il faut se garder de brûler les étapes et bien souvent accepter d’une femme une forme de passage au purgatoire, une sorte de mise à l’épreuve. J’ai grand-peine à m’y faire si bien que plus d’une fois l’aventure a tourné court, à l’étonnement de la dame et, paradoxalement, à la ma grande déception. Pour l’heure, je suis entré dans le pire scénario ; je dois me résigner.
Le lendemain, en fin d’après-midi, Amélie entra dans mon bureau pour m’annoncer qu’elle rentrait. « Je t’attends » me dit-elle d’une voix dont les vibrations parcoururent mon dos, et même plus bas encore. Elle s’appuyait sur l’angle de ma table et je crus un moment qu’elle allait y frotter son pubis, saillant sous un pantalon moulant ; elle l’aurait fait, sans doute, si le meuble avait été à bonne hauteur. La nuit à venir s’annonçait sous de meilleurs augures que la précédente.
Me voici de nouveau à sa porte.
– Qui est-ce ?
C’est bon signe : elle n’est pas en état de recevoir n’importe qui.
En effet, Amélie est « vêtue » d’une nuisette à ras-le-bonbon, les cheveux lavés de frais. Une femme qui veut séduire soigne ses cheveux ; elle les dénoue s’ils sont longs, les lave s’ils sont courts. Rassuré par ce premier contact, je m’assieds sur ce qui avait été mon lit de souffrance et je regarde des cuissettes aller et venir dans la pièce, sans but apparent. Il me suffit d’attendre. Ce ne sera pas long. Les voici à mes côtés. Je tends la main ; Amélie bascule sur moi, se renverse sur le dos. La nuisette remontée au nombril, je contemple avec étonnement des jambes de fillette et un ventre de femme marqué par la maternité ; entre les deux, une sage culotte de coton blanc.
La détermination d’Amélie est si évidente que j’oublie tout préambule : « Viens ! ». Elle se lève d’un bond « Pas question ! » se rhabille. Penaud, je la suis au resto U. Nous prenons notre repas copain-copain, puis rentrons de même.
A peine revenus dans la chambre, je vois réapparaitre la nuisette. Amélie se met au lit, sans tirer la cloison, cette fois, ouf ! Elle a laissé de la place à côté d’elle ; je suis invité à la rejoindre. Je me déshabille, soulève le drap. La nuisette, de nouveau remontée sur le nombril, laisse voir que la culotte blanche a laissé place à un très beau triangle noir, luisant, très seyant.
Amélie est absorbée par la contemplation du plafond.
– Tu es tout nu ?
La voix se veut indifférente.
– J’ai gardé mon slip.
– Oh, moi ça ne me fait rien.
J’ignore délibérément l’invitation ; j’ai mon plan.
Un soutien-gorge bien trop épais, doublé de la nuisette en accordéon, barrent le torse d’Amélie.
– Tu ne veux pas quitter ça ?
– Je n’ai pas une belle poitrine.
– Ce n’est pas grave.
Les derniers vêtements disparaissent avec empressement. Me voici dans le lit d’Amélie, nue. Je ne suis pas déçu ; les seins, certes alourdis par l’allaitement, sont encore beaux et agréables à caresser. Lumière éteinte, ventre contre ventre, nous discutons aimablement en nous laissant aller au sommeil. Quand je la sens doucement sombrer, je mets mon plan à exécution. Je baisse traitreusement mon slip, libère mon sexe turgescent de son douloureux carcan et le plaque contre elle. Une décharge électrique la secoue de la tête aux pieds. J’ai gagné ; toute résistance est anéantie. Je la bascule doucement sur le dos, me glisse entre des jambes qui ne demandent qu’à s’ouvrir et la pénètre.
Amélie gémit un peu, puis fait mine de délirer, appelle son mari : Jacques…, Jacques…
Il est des moments où rien n’est plus désagréable à un homme, ou une femme, que d’entendre un autre nom que le sien. Si elle pense me décourager ainsi, elle se trompe. Je suis dans la place, j’y reste. Elle finit pourtant par me repousser. Il faut se résoudre à dormir. Facile à dire, avec un sexe douloureusement tendu. Un peu plus tard je la sens dormir en chien de fusil, les fesses tournées vers moi. J’envoie une main en reconnaissance. Le sexe, toujours chaud et turgescent, appelle désespérément le mien. Comment rester insensible à une telle détresse ? Je le pénètre de nouveau, mais rapidement Amélie se retire. Je n’insiste plus.
Les soirs suivants, Amélie s’émerveillait de mon sexe en érection, comme une gamine qui aurait reçu la poupée de ses rêves. Elle le contemplait, le caressait, le suçotait du bout des lèvres, en jouait jusqu’au jaillissement final. Au comble de la joie, elle aurait battu des mains, si elles avaient été libres.
Elle prétendait devoir consulter je ne sais quel psycho-quelque chose pour faire le deuil de son mari et ne pas être perturbée par une transition trop brutale, ou autre faribole de ce genre. En fait, il était clair que je n’étais pas arrivé au meilleur moment ; il fallait attendre que la période critique passe.
Plusieurs soirs passèrent ainsi. Tout cela était bel et bon, mais je commençais à m’impatienter, lorsque qu’arriva enfin le soir où elle écarta les cuisses et m’attira à elle. Nous avons fait l’amour longtemps. J’avais lu dans une étude – américaine bien sûr – qu’une veine bleue parcourt pendant l’orgasme de la femme, coiffe le clitoris. Cette veine, je la voyais se dessiner, s’intensifier, prête à éclater.
Amélie était ailleurs, dans un monde fait de sérénité, de bonheur tranquille, soudain troublés par de fulgurantes douleurs. Elle paraissait alors souffrir à tel point que j’hésitais à poursuivre. Sa bouche se tordait, son corps était secoué de spasmes. Se peut-il que la souffrance et la jouissance se rejoignent à ce point ? Comment ce petit bout de mon corps peut-il provoquer un tel déchaînement ?
Enfin elle s’apaisa. « Tu m’as fait jouir trois fois ! » Elle l’avait dit dans un souffle, sans quasiment bouger les lèvres, et j’eus l’étrange impression que c’est son sexe qui me parlait. Les psychiatres disent qu’une femme doit porter son sexe sur sa figure. Pour une fois – c’est bien la seule – je suis d’accord avec eux. J’avais une amie dont les lèvres du haut et du bas enflaient pareillement. J’embrassais longuement, goulument, les unes et les autres, étalant sur sa bouche le musc puissant dont je m’imprégnais entre ses cuisses. Elle devait avoir l’étrange impression d’embrasser son propre sexe.
Je ne sais rien de plus beau qu’une femme pleinement satisfaite. La chair se détend, encore gonflée et frémissante de ce qu’elle vient de connaître. Un rire monte par saccades du plus profond de la poitrine, tourbillonne dans la gorge pour éclater en pleine bouche. Les yeux disent que le bonheur existe sur terre.
La vie avec Amélie était facile. Ses rapports avec l’homme étaient très simples : un étalon demande soins et attentions, tout bon éleveur sait cela. Je me laissais soigner, cajoler. Mon seul rôle était de la satisfaire, à la demande, c’est-à-dire à tout bout de champ, pour peu que nous en ayons le loisir.
Mais, bêtement, toute année scolaire a une fin. Amélie a rejoint sa mère et son enfant, quelque part au centre de la France. Quand je l’ai revue, quelque mois plus tard, j’appris sans étonnement qu’elle m’avait remplacé. Dans sa nouvelle chambre, peu meublée, nous étions assis par terre, adossés au mur. Amélie était recroquevillée dans un angle, les bras enserrant ses jambes repliées, comme pour leur interdire de céder à la tentation. Mais dans ses yeux je me reflétais comme un gros sucre d’orge. J’aime cette lueur dans le regard d’une femme. Je ne crains pas s’être un sex-symbol ; le mot est laid, mais la chose est belle.
J’imaginais sans peine l’état du sexe d’Amélie. Mes doigts pouvaient de nouveau se perdre dans les replis infinis de ses lèvres soyeuses, qui s’écarteraient encore pour mieux m’accueillir. Mais l’idée de m’immiscer entre elle et cet homme que je ne connaissais pas me déplu. Je la quittai, indifférent au spasme qui a dû alors douloureusement crisper ses cuisses. Je n’ai jamais plus revu Amélie.
Illustration: Le Livre de Poche

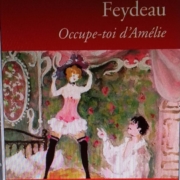




Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!