 II – De Izmir à Antioche
II – De Izmir à Antioche
Vendredi 16 juillet
Notre ferry est déjà reparti. Un dernier coup d’œil au port tranquille et nous prenons la route. L’objectif est de rejoindre Antioche, ce qui implique de traverser la plus grande part de cette énorme masse montagneuse qu’est la Turquie. Longue de plus de mille kilomètres, elle est née du choc des plaques Afrique-Péninsule arabique et Europe-Asie, confrontation titanesque qui se poursuit encore pour donner naissance à la Mer Rouge, prolongée par une faille qui a créé l’alignement Golfe d’Akaba – Mer Morte – Lac de Tibériade – vallée de l’Oronte. Cette faille continue de s’ouvrir et va donner naissance à une nouvelle mer, au détriment de la Méditerranée qui, elle, progressivement se refermera. Cette situation est l’origine des catastrophes sismiques qui périodiquement secouent la région, de la Grèce à la Turquie et à l’Iran, en passant par la Syrie. A ces chocs de la croûte terrestre se sont superposés les heurts des civilisations.
Le plus simple serait de passer par la plaine intérieure, via Konya. C’est la route suivie par les Croisés pour, comme nous l’avons dit, se heurter immanquablement à la muraille des Monts Taurus, et pour unique issue l’impressionnante percée des Pyles. Sans consulter mes compagnons de voyage, je choisis l’alternative du bord de mer, donc longer la plaine d’Aydin, pour rejoindre le littoral à Antalya. Au-delà, nous suivrons la côte. Ce ne sera certainement pas facile car la montagne va plonger directement dans la mer. J’ai quelques appréhensions, qui s’avèreront amplement justifiées.
Au départ de Çesmes, le paysage est d’abord granitique et desséché, comme une Bretagne qui aurait été transportée dans le Sud. De petits immeubles récents, apparemment pour vacanciers, forment de curieux entassements aux couleurs inspirées des bonbons des Vosges, spectacle étonnant dans cette zone désertique. Nous passons au large d’Izmir, au loin immense masse grise, et nous entrons dans un jardin d’un vert intense. A perte de vue, tout est soigneusement entretenu, arbres fruitiers, dont beaucoup d’orangers, champs de coton et de légumes.
Mais voici que la plaine se termine. Il faut entamer la traversée des Monts Taurus. Sur le plateau qui sépare Denizli de Antalya, un orage éclate, violent (1). Quand enfin il s’apaise, une halte paysanne nous offre un moment de répit. Nous les connaissons bien en Syrie : une méchante cabane de parpaings, une treille, une mauvaise table et quelques sièges déglingués. L’accueil qu’on y reçoit fait partie de l’agrément des voyages syriens. Nous découvrons qu’il en est de même dans cette région. Seule la langue diffère ; une frontière a séparé arbitrairement deux populations-sœurs, comme c’est bien souvent le cas.
Une gamine aux yeux rieurs ranime le feu d’un samovar et y pose une théière. Deux femmes se précipitent dans le jardin voisin pour en ramener de la verdure. L’une allume des brindilles sous une plaque convexe, pendant que l’autre pétrit la pâte qu’elle étale avec un mince bâton. Le geste, séculaire, est harmonieux, souple régulier, dansant. La pâte semble s’étaler seule. Elle est bientôt garnie de verdure et de fromage, puis refermée, et le même bâton la place sur le feu. Peu de temps après, nous sommes attablés devant des chaussons dorés à point, le thé de la petite fille, ainsi que tomates et concombres apparus en même temps que le garçon de la famille. Ces moments-là sont irremplaçables.
Antalya. Nous roulons longtemps dans une ville moderne sans charme puis, estimant être près du port, décidons de stopper dans un terrain vague baptisé Autopark. Un hôtel, acceptable pour une nuit nous dit-on, est proche, nous nous y installons. Nous avions raison, la vieille ville et le port, la Marina, sont à quelques pas. La promenade qui surplombe le port est agréable, mais la vieille ville est décevante. Les vestiges sont rares, les anciens bâtiments sont dénaturés ou en ruine. Antalya n’est malheureusement pas une exception : nous constaterons que les Turcs ne se préoccupent pas de préserver un passé qui, pour l’immense majorité de la population, n’est pas le leur. Encore une fois, nous choisissons un restaurant en fonction du volume sonore, le plus supportable possible. Le repas est très agréable, les kebabs toujours délicieux.
Samedi 17 juillet
La plaine côtière d’Antalya est belle. Le paysage se couvre de bananeraies. Les problèmes routiers, sérieux, commencent à partir d’Alanya. Il faut imaginer une route des Cévennes qui supporterait un trafic autoroutier, le tout transporté sur la Côte d’Azur. On grimpe une côte raide, où un virage se cache derrière chaque virage et où chaque camion cache un camion. On monte jusqu’à surplomber la mer de quelques centaines de mètres, puis on redescend, avant de remonter, pour redescendre encore. Il faut tout tenter pour doubler d’interminables convois qui roulent au pas, sous peine de passer la journée derrière ces masses fumantes et malodorantes.
Nous faisons halte. Une cabane, avec sa tonnelle, est installée sur un replat qui domine la Méditerranée du haut d’une impressionnante falaise. Une vache maigre sort sa tête par une petite fenêtre, des poules vaquent dans la cour, au bord d’un chemin qui plonge vers la mer. Jusqu’en bas, le moindre replat est planté de bananiers. Avant que nous repartions, la femme de notre hôte grimpe sur le toit d’un cabanon adossé au talus et cueille pour nous les offrir quelques grappes de la vigne qui s’étend sur la tôle.
Nous reprenons la route dans les pins. Les kilomètres défilent avec une lenteur exaspérante. La prochaine étape, Anamur, est toute proche mais elle paraît inaccessible. Des panneaux indiquent les sites archéologiques qui truffent la côte. Grecs, Romains, Phéniciens, Byzantins, sans citer leurs prédécesseurs, ont colonisé le littoral, en évitant de s’aventurer à l’intérieur du pays, d’ailleurs impraticable. Le frère de Yasmine nous avait parlé de ces sites et leur grande beauté. Pourtant nous restons sourds au chant de ces sirènes. Sortir au plus vite de ce qui est devenu un traquenard, telle est notre obsession.
Enfin, voici Anamur. Nous dégustons sur la plage quelques brochettes agneau-aubergines réconfortantes, puis de nouveau la route. Nous allons devoir connaître encore un trajet sinueux, mais sans comparaison avec ce qu’on vient de traverser. Effectivement, les virages s’élargissent progressivement et enfin la route devient normale. Voici Silifke.
« Une ville endormie sur les bords du Göksu » dit le Routard. C’est hélas tout ce qui reste de la prestigieuse capitale de la Cilicie arménienne, un entassement morne d’immeubles gris-verdâtre. La citadelle est toujours là, heureusement, qui domine fièrement la ville. Au pied des murs on peut voir une rangée de grandes baies vitrées qui évoquent un restaurant. Après nous être installés dans un hôtel « correct », nous filons prestement vers le sommet de la colline. Dans la lumière dorée du soleil couchant, les larges méandres du Göksu nous paraissent harmonieux et la ville presque belle. Ce sera bien mieux quand nous les contemplerons en savourant les délices qui nous attendent dans le restaurant panoramique que nous voyons, au pied du glorieux édifice dont les murs majestueux s’approchent.
Pas de chance, le restaurant est loué pour un mariage. Tant pis, allons voir la citadelle. Nous cherchons la porte d’entrée, en vain. Sur les côtés, les murs disparaissent sous des décombres. Nous les escaladons, exaltés, nous allons enfin voir l’intérieur. Quel intérieur, décombres encore, décombres partout ! Rien n’a été préservé. Seuls les murs extérieurs, la partie visible, ont été conservés. De la splendide citadelle arménienne il ne reste qu’un décor de carte postale. Nous l’avons vu à Antalya, nous le voyons ici, c’est encore vrai en Cappadoce où les églises éventrées sont livrées au vent et à la pluie. C’est le génie des Turcs de ne rien réparer disait déjà, il y a un siècle, Louis de Corancez (2). Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites ! Hélas !
Dans l’obscurité maintenant tombée, à la recherche d’un restaurant nous nous heurtons comme des papillons de nuit à la lumière trompeuse d’enseignes publicitaires. Nous finissons par trouver quelque chose qui pourrait ressembler à ce que nous cherchons. Nous mangeons dans l’obscurité, ce qui heureusement nous évite de voir le contenu de nos assiettes.
Vous qui verrez Silifke, passez votre chemin !
Dernière étape. Encore quelques agglomérations balnéaires stéréotypées, et voici l’autoroute. Nous traversons les collines qui bordent la vaste plaine d’Adana. Les larges ondulations du terrain sont couvertes d’arbres fruitiers parfaitement soignés ; pas une seule touffe d’herbe n’est tolérée entre les troncs. Au loin est la ville de Tarsus, masse grise elle aussi. Yasmine nous parle de son grand-père. Il élevait des vers à soie dans la région d’Antioche et apportait ici ses cocons pour dévider le fil. Reste-t-il quelque chose de cet artisanat ? Après avoir un peu hésité à faire un détour à la recherche de ce passé devenu tout à coup si proche, nous continuons notre chemin.
La plaine se resserre. L’autoroute entame une rude montée pour franchir l’Amanus, un bras des Monts Taurus. La température ambiante s’élève sérieusement et le moteur donne de dangereux signes de surchauffe. Nous passons au-dessus d’Iskenderun. Entre montagne et mer, la ville montre une industrie lourde et un port qui parait très actif. Parvenus au sommet, nous pouvons dévaler la pente vers Antioche, capitale du premier Comté Franc de Syrie, qui n’est plus en Syrie. Si nous, Français, sommes dispensés de visa d’entrée en Turquie, c’est par reconnaissance, car le Hatay, la région d’Antioche, a été cédée aux Turcs par la France, au mépris du droit international (3). Pourtant l’Amanus est une frontière naturelle qui isole clairement la Turquie de la riche vallée de l’Oronte. Ce n’est pas un hasard si les Croisés ont pris pied sur cette porte naturelle de la Syrie, comme bien avant eux, le Grec Alexandre le Grand. Antigone, son héritier, y fonda Antigonia, future Antioche, en l’an 306. A Antioche se rejoignaient les trois principales routes de l’Asie Antérieure: 1° la Voie Royale qui allait de Sardes en Egypte par Iconium, Tarse, les pyles ciliciennes, Tyr et Gaza ; 2° la route qui descendait l’Euphrate par Thapsaque et Babylone jusqu’au golfe Persique ; 3° enfin la piste de caravanes qui, par Hiérapolis, Nisibe et Ecbatane, gagnait Bactres et la Haute Asie (4). Coupée de son pays, Antioche est maintenant une impasse, une excroissance bizarre sur la carte de Turquie. Une voie millénaire transformée en impasse !
Antioche était bien plus qu’un passage. Ecoutons encore René Grousset: « Antioche […] eut pour elle un des sites les plus agréables de l’Orient. Entre les pentes boisées du mont Silpios et l’Oronte, elle offrait au voyageur à peine sorti du désert, ses jardins de myrtes, de buis fleuris et de lauriers, ses grottes, ses cascades, son grand corso, ses temples, ses bains et ses portiques où se pressaient une population de toute race, de tout culte, de tout dialecte, la plus affairée, la plus bruyante et la plus mobile population du Levant. La capitale séleucide était à la fois un centre d’affaires et une ville de plaisirs. Elle était célèbre par ses courses et ses fêtes, le luxe qui s’y étalait, les cultes élégants et légers de ses Apollons et de ses Nymphes, toute une vie cosmopolite de bazar levantin. On parlait d’elle sous les grandes tentes de l’Arabie comme au fond des campements parthes et sans doute jusque dans les cités indo-grecques de la vallée du Caboul. A neuf kilomètres de la grande ville, dans un paysage de lauriers, de cyprès de gazons et de fontaines, se trouvait « les délices d’Antioche », Daphné, cité des eaux. Cette bourgade, qui renfermait un temple d’Apollon Pythien, était la villégiature favorite des Syriens élégants, « un Tibur oriental ».
Daphné fut, dit la légende, transformée en laurier (le Bois-Joli, le bien nommé) pour avoir fui Apollon. Le mont Silpios dont parle Grousset est adossé à un immense plateau calcaire. Sur ces hauteurs semi-arides, depuis des siècles les paysans Kurdes repoussent les colonnades et les blocs sculptés des édifices byzantins tombés à terre pour faire place aux oliviers, tandis que les moutons s’engraissent en mangeant on ne sait quoi, car l’herbe est quasi inexistante. L’eau s’infiltre ici et resurgit au pied de la montagne de Daphné, s’épanche en torrents et cascades, s’enfonce dans la verdure, pour ressortir plus bas, et disparaître encore. De tous côtés, l’eau jaillit, ruisselle, chute, disparait, réapparait, serpente encore. Pourtant ce que nous voyons, nous dit Yasmine, n’est qu’un vestige des splendeurs passées, car beaucoup de sources ont été captées pour les besoins de l’agglomération. Splendides vestiges, tout de même. On vient en famille les soirs d’été et les jours fériés. On loue une table, rapidement couverte de victuailles. Les kébabs et poulets prennent place sur les braises et, dans la fraîcheur, les pieds dans l’eau courante, on mange joyeusement. La langue arabe est restée bien vivante (5). Yasmine peut enfin s’exprimer dans sa langue maternelle et moi je retrouve les sonorités qui traduisent la chaleur de l’accueil, la familiarité des relations, même entre inconnus, la musicalité qui se dégage d’une société sereine et solidaire. Ces gens sont restés syriens de cœur, tout en glorifiant la Turquie, et la France qui les a faits Turcs. Moralité, peu importent les découpages politiques, les hommes restent ce qu’ils sont (souvent !).
Il est impossible de passer à côté d’une table sans être chaleureusement convié à partager le repas. Nous ne pouvons pas décliner totalement les invitations et dédaigner tous les plats qui nous sont tendus. Nous en goûtons avec plaisir quelques-uns, de ci de là, avant de gagner le secteur « service à table ». Le repas est bien sûr délicieux et le service chaleureux.
Partant de là, Croisés avaient longé la côte pour rejoindre Jérusalem. En ce qui nous concerne, nous irons directement à Alep. La frontière franchie, nous stoppons près d’une arche pour, nos pas dans ceux des soldats d’Alexandre, goûter l’incomparable, la délicieuse fraîcheur apportée par le vent d’Ouest qui s’installe. Nous sommes précisément à Bab El Hawa (la porte du vent). Tout est calme et reposant ; la lune, épanouie, radieuse, nous sourit.
Il nous revient en mémoire Le Vallon de Lamartine :
Repose-toi mon âme, en ce dernier asile
Ainsi qu’un voyageur qui, le cœur plein d’espoir,
S’assied, avant d’entrer aux portes de la ville
Et respire un moment l’air embaumé du soir
- Taurus, le taureau, est une divinité de l’orage ; d’où le nom du massif.
- Louis de Corancez, Itinéraire d’une partie peu connue de l’Asie Mineure. Antoine-Augustin Renouard, Paris, 1816.
Pourtant, lors d’un séjour ultérieur nous avons découvert le remarquable nouveau musée de la ville. Il ne faut donc pas désespérer de nos amis Turcs quant à la préservation du patrimoine qui est sous leur protection.
- Le mandat confié à la France comprenait, outre le Sandjak d’Alexandrette, c’est-à-dire la région d’Antioche, ainsi que la Cilicie que nous venons de traverser, où les français n’ont pu se maintenir.
- René Grousset, l’Empire du Levant, Bibliothèque historique Payot.
- Après la prise de possession d’Antioche, les Turcs avaient interdit l’usage de la langue arabe, comme était interdit le provençal dans les écoles communales de Provence. Les choses ont bien changé depuis.






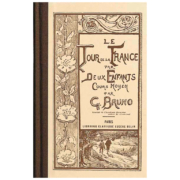


Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.