J’avais une dizaine d’années lorsque, pour la première fois, je pris un livre en main. Je ne l’avais pas acheté. Chez nous personne n’aurait eu l’idée saugrenue d’acheter autre chose que l’essentiel, nourriture et habillement. Ce livre, je l’avais sauvé des flammes qui consumaient un tas d’ordures. Par chance, seule la couverture avait été endommagée, le reste étant intact même s’il s’en dégageait une écœurante odeur de déchets carbonisés.
Ce livre m’a ouvert à l’écriture, en même temps qu’il m’avait fait découvrir un pays dont j’ignorais tout, où pourtant j’habitais : la France. J’habitais en France, mais mon pays était celui de mes parents, proches ou plus lointains, le pays des amis de la famille, celui dont j’entendais parler tous les jours, le pays de ma première langue, l’Italie. Longtemps seul avec mon père, émigré, que j’avais accompagné dans ses déplacements, tous deux survivants de la guerre (une guerre ne s’arrête pas à la signature d’un accord de paix), j’avais suivi une scolarité chaotique, dont je n’ai gardé aucun souvenir, balloté d’une classe à l’autre. Ce livre m’ouvrait un monde en même temps qu’un mode de vie dont j’avais tout à connaître. Il était destiné aux enfants de mon âge qui, certainement, ne connaissaient guère plus que moi leur pays et à qui on avait entrepris d’enseigner les qualités d’un bon petit Français : politesse, propreté, courage, obéissance, ardeur au travail, esprit de famille et, n’oublions pas, patriotisme, valeurs réitérées à l’envi d’une page à l’autre. Ces valeurs ne m’atteignaient guère, non pas que je les reniais, mais j’étais imperméable à ces leçons de moralité béate.
Le livre avait été écrit par une femme, Augustine Feuillée, après la guerre franco-prussienne et l’annexion de l’Alsace-Lorraine, mais publié sous un nom d’homme, plus exactement sous un patronyme qui évoque un auteur masculin, G. Bruno (Colette n’avait pas encore marqué la littérature ; elle venait de naitre).
Un livre pas exactement revanchard, toutefois destiné à exalter le « génie français » et montrer qu’il n’avait pas souffert de la défaite.
La France d’après-guerre, de 1945, avait peu évolué depuis l’après-guerre de 1871. La révolution industrielle avait fait son apparition, sans encore affecter notablement la vie quotidienne. La principale force motrice était toujours animale ou à vapeur. Dans les campagnes chevaux et bœufs tiraient charrues et charrettes. Sur les routes ou en ville, très peu de voitures ; on se déplaçait à vélo ou en train, à vapeur. Les embouteillages qui paralysaient les rues de Grenoble, ville plate bien qu’insérée dans les montagnes, étaient le fait des cyclistes. Le moteur de Rudolf Diesel, volumineux et lourd, restait cantonné aux usines. Bref, la France que je découvrais dans les lignes d’Augustine Feuillée, alias G. Bruno, était toujours celle dans laquelle je vivais quarante ans plus tard.
Je ne repris mes lectures qu’après des années. A l’arrivée des Livres de Poche, la lecture devenait enfin accessible aux budgets réduits à peu de choses, comme le mien. Je découvris Zola et les ouvriers-esclaves des premiers temps de l’industrie, qui s’enfonçaient à plus de mille mètres sous terre et emplissaient leurs poumons de poussière de charbon pour faire de la France un grand pays. Une fois hors de ce trou, ils s’enfonçaient dans un autre, celui-là plus profond encore, l’absinthe, dont le méthanol détruisait peu à peu leur cerveau. Je découvris Mauriac et la vie de ceux « qui ont des sous », une vie bien étrange et peu enviable à mon goût.
Surtout je rencontrais André Gide, le personnage et ses écrits. Je l’ai redécouvert récemment, grâce aux livres électroniques qui ont l’immense avantage d’être immédiatement disponibles pour une poignée d’Euros. J’étais curieux de le revoir après tant d’années. Allais-je retrouver le grand prosateur qui m’avait séduit ? La réponse fut : oui. Dans l’ignorance où j’étais alors de la chose écrite, je ne m’étais pas trompé. Ce français qui n’est pas ma langue maternelle, qui m’est donc un peu étranger, je le voyais chez Gide dans toute sa richesse, sa pureté et, ce qui m’avais frappé, sa simplicité. Une simplicité qui n’est qu’apparence, plus exactement une économie de mots, qui contraste avec la profondeur du récit, une langue fluide, qui nous entraine sans ne rien faire voir de sa complexité. Pour comprendre à quel point cette écriture est élaborée, en dépit des apparences, il faut la lire à voix haute ; on réalise alors qu’on ne peut dire une phrase sans d’abord la saisir dans son intégralité.
Je relus La Porte étroite. Sans entrer dans l’aspect religieux sous-jacent, ces deux mots se heurtent ; une ouverture et en même temps des difficultés entrevues. Deux mots, tout est dit.
Il est difficile de séparer un texte de son auteur, ce qui n’est pas en faveur de Gide. Sa physionomie n’est pas avenante, traduisant un intérieur sombre. Sans doute n’a-t-il pas bien vécu un mode de vie où, comme dans sa littérature, les femmes ne sont que des anges éthérés. J’en veux pour exemple, encore une fois, La Porte étroite où les amours de Juliette et Abel, ou encore Alissa et Jérôme, n’aboutissent pas. Amours inexorablement condamnés au terme de longues et belles pages, un magnifique chant du cygne, certes, un cygne qui aurait toute sa beauté, mais dans un univers sans couleur, réduit à un camaïeu de blanc. La fréquentation d’une femme fait entrer un homme dans une autre dimension. Il retrouve chez elle ce qu’il a en lui, la couleur en plus ; réciproquement pour une femme
J’apprécie à leur juste valeur les grands auteurs, pourtant combien ont la fluidité de Gide ? La plume de Gide, c’est la main de Picasso qui se déploie dans l’espace pour faire apparaitre, d’un trait, une colombe. Une colombe que tous connaissent et reconnaissent ; tous disent en la voyant : Picasso. De même, dès la première ligne, on entre chez Gide, on s’y sent bien et on y reste. C’est vrai aussi, plus modestement pour certains auteurs contemporains, reconnaissables dès la première phrase. Ce ne sont pas nécessairement de grands prosateurs, telle Janine Boissard, qui nous prend la main, nous dit tout simplement « venez avec moi » et sans y penser nous la suivons dans son univers. Les auteurs sont nos compagnons de route, nous accueillent chez eux, nous entrouvrent leur intimité. Ecrire c’est se dénuder.
L’écriture est une musique ; elle nous entraine, nous captive à la manière d’un chant. Les mots résonnent, chacun à sa hauteur, à son vibrato, les phrases les scandent, les rythment, les animent. Les pieds des danseurs émeuvent [le sol] nous dit La vagabonde de Colette; la plume de l’écrivain crée cet émoi, cette vibration, qui se communique du papier à la table, à la pièce, à ce qui nous entoure, à nous, en nous.
Un bon livre est une belle chanson et comme elle nous imprègne, prend place dans notre vie. J’entre toujours dans une librairie plein de cet espoir, entendre une belle musique, faire la belle rencontre d’un auteur remarquable, un auteur qui, avec les mots de tout le monde écrit comment personne [Colette]. A chaque fois une montagne de livres, comme foule de promesses, hélas une foule d’ombres ! Ombres revêtues des plus beaux habits et parées des plus belles couleurs, ombres tout de même. Comment ne pas penser à Voltaire, parlant des Grecs qui ont écrit tant de phrases et si peu de choses.
Néanmoins on peut faire de belles découvertes dans une librairie, bien rares hélas (sans parler, bien entendu, de la littérature classique).
Je dis que le français n’est pas ma langue maternelle, car mes parents employaient une langue purement orale, parlée par seulement quelques milliers de personnes dans une vallée des Alpes italo-autrichiennes ; je n’ai pas eu le temps de réellement la maîtriser car mon foyer s’est disloqué alors que je n’avais pas dépassé les premières années de ma vie.
En revanche, ces origines chaotiques m’ont, indirectement, donné accès à une langue merveilleuse, l’italien, et par voie de conséquence à une littérature d’une grande richesse. Nous, Français, avons laissé notre langue s’appauvrit, à tel point que si quelqu’un s’inspirait du parler de Molière, il serait ridiculisé. Les étrangers qui ont appris chez eux un français classique, arrivant chez nous sont raillés. Pire, les comédiens, ceux qui font profession de clamer haut Molière et le faire entendre dans toute sa pureté, semblent souvent saisis de je ne sais quel sentiment de honte sur scène, y compris sur les plus grandes scènes. Résistant à la tentation de réécrire cette belle prose, ils la noient dans des mimiques grotesques, la hachent au point de la rendent méconnaissable. On donne une œuvre classique, mais on veut « l’actualiser » comme, à l’opéra de Paris, faire entre une automobile chez Verdi. Grotesque !
Les Italiens, eux, ont le respect de leur langue et l’ont conservée dans toute sa beauté, dans toute sa complexité. A l’exception, naturellement, de ce qui s’entend dans les conversations courantes, ce peuple manie avec adresse l’art de l’oralité et pratique des formes grammaticales que nous avons depuis longtemps vouées aux gémonies. Ajoutant à l’oral l’art de l’écrit, avec un vocabulaire dense et harmonieux, les Italiens nous apportent, en littérature, l’équivalent des richesses culturales dont leur pays regorge, au point de ne pas disposer de moyens suffisants pour leur seule préservation.

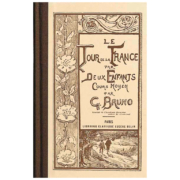






Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!