Ma mère
Une charrette attelée d’un cheval. Quatre-vingt ans après, l’image est toujours aussi nette. Quatre-vingt ans, une longue vie dit-on ; en réalité une vie, point. Une image nette, non pas, une idée, un souffle qui vient de si loin, l’idée d’un cheval et d’une charrette qui me hante. Comment était-il ce cheval, comment était cette charrette ? Inutile d’en vouloir plus ; inutile de forcer cette flamme vacillante ; le cheval et la charrette prendraient corps, mais ce ne serait plus le même cheval, ni la même charrette. Restons-en là : une charrette attelée d’un cheval, point.
– Qu’il est mignon ce petit, dis-moi, quel âge as-tu ? – Trois ans et demi, madame. Important le « demi » ; l’omettre serait grandement amputer la vie de ce petit.
Qu’il y avait-il dans la charrette attelée d’un cheval, il ne le sait pas, le petit de trois-ans-et-demi. C’est sa grande sœur de neuf-ans-et-demi qui, bien plus tard, a animé en même temps que légendé cette image figée et muette dans la tête du petit : le cheval l’avait terrorisé et il transportait dans la charrette une femme à l’agonie, sa mère, notre mère.
C’est le dernier et seul souvenir de ma mère, qu’en réalité je n’avais pas vue ce jour-là, pas plus que le Petit Prince n’avait vu le mouton dans la caisse. Ensuite, plus rien. Moi, le petit garçon de trois-ans-et-demi je m’étais donc dit, avec toute la logique de ma petite tête, que la charrette attelée à un cheval l’avait emmenée, pour toujours. La réalité était un peu, si peu, différente. Ce n’est pas le cheval mais une ambulance qui s’était chargée de faire disparaitre une mère qui avait voulu quitter une vie devenue insupportable, entre un compagnon qui la frappait et sa fille de treize ans, ma demi-sœur, qui couchait avec lui. Avec, au-dessus de tout, la guerre qui la tenait prisonnière, loin de son seul soutien, ses parents, en Italie, un pays devenu soudain ennemi.
Nous avions pourtant été heureux, avant. De cet avant, j’en ai une image, bien nette celle-là, une photographie prise en studio à Barcelonnette peu après ma naissance, mais je ne l’ai découverte qu’à une date récente. Le photographe de Barcelonnette avait soigné sa composition. Je suis à six mois sur les genoux de ma mère assise, ma sœur Wanda debout près de nous. Derrière est mon père avec dans ses bras Bruno, mon ainé d’un an. Ma mère, cette brave, trop brave femme, avait revêtu ce qui était sans doute sa plus belle robe, une robe noire avec pour seul ornement une collerette de dentelle blanche. Une robe noire, véritable uniforme pour les femmes de son village, Noiaris, là-bas en Italie, comme Jausiers, ici en France. Deux villages qui se ressemblent tant, les mêmes maisons des mêmes paysans, enserrées des mêmes montagnes. Elle n’a que trente-quatre ans et parait déjà sans âge. Elle regarde loin derrière le photographe, un avenir qui ne lui sourit pas.
Ele s’était mariée, sans conviction, avait fait deux enfants, mes demi-sœurs Carmen et Wanda. Sur une autre photographie, une des rares que je possède, elle est lors du baptême de sa fille, morose, résignée au milieu de ces gens qui ont organisé malgré elle une cérémonie où elle se sentait étrangère, jusqu’à ce représentant du Duce, qui impose le nom de la petite, Vittoria Romana. Mussolini était attentif aux familles pourvoyeuses de la main-d’œuvre nécessaire à ses grands et sinistres desseins. Cette femme, tout cela ne la concernait pas. Puis d’autres enfants sont venus. Combien en tout, cinq ? six ? On ne sait pas exactement. Cette Giuseppina inscrite puis rayée de son passeport, qui était-elle ? Personne ne sait. Et d’autres mystères subsistent encore.
Pour la photo de famille, elle a vêtu ses enfants avec soin. Malgré sa belle robe blanche et se ses sandalettes d’été dont elle était fière, à n’en pas douter, Wanda, sa fille cadette ne semble pas plus confiante qu’elle. Quant à l’ainé des garçons, il est lui franchement inquiet et hostile. Seul le poupon que je suis est apaisé. Sur les genoux de ma mère, dans une main un reste de biscuit, probablement, je regarde avec une curiosité d’enfant le spectacle qui se joue devant lui. Cependant ma mère, elle, a toutes les raisons de ne pas sourire à l’avenir, malgré ses jeunes enfants et malgré un compagnon qui aurait dû être son soutien.
Elle avait auparavant régulièrement côtoyé ce cousin d’un bien terne mari et n’avait pas manqué d’être attirée par la force vitale qui s’en dégageait, avec un regard clair, insistant. Inévitablement, elle avait cédé. Les émigrés italiens de la région s’étaient réunis en congrès à Marseille si bien que, dans un hôtel de la rue Belsunce elle connut, dit-elle dans une lettre parvenue jusqu’à moi, « deux heures de consolation dans ses bras ». Puis, les lettres la retrouvent à Cannes avec son mari, chez une cousine du couple – dans ce petit village qu’on ne quittait jamais, surtout pas pour se marier, on vivait entre cousins. Elle se morfond et se repent de n’avoir pas cédé à l’insistance de celui qui la voulait près de lui. Son mari veut-il repartir en Italie, eh bien ce sera sans elle. Elle revient dans des bras qui l’appellent. Hélas, au bout des bras il y a des poings qui s’abattent sur elle. « J’avais oublié que tu es méchant », écrit-elle. Elle se réfugie de nouveau chez la cousine, mais celle-ci va partir à son tour et, catastrophe, des nausées la conduisent dans une « maternité gratuite » pour apprendre qu’elle « souffre de la maladie des neuf mois ». Alors elle demande au père « Veux-tu de cette creaturina qui viendra au monde ? Pour moi, ti voglio encora bene – j’adore cette expression si pleine de tendresse que les Italiens emploient volontiers, au lieu d’un « je t’aime » bien plat.
Qui a bu boira et qui a frappé sa femme la frappera encore. Pourtant, cette brave femme, avec son enfant à naître, sans argent et en butte à des difficultés administratives dans un pays qui n’est pas le sien, espère encore vivre une relation apaisée. La voici donc de nouveau auprès de cet homme qui reconnaitra son enfant et lui en fera un autre, moi.
Nous voici donc tous réunis pour cette photographie même si, déjà, un enfant manque. Mon père est droit et fier. Il a toutes les raisons de l’être. Il a surmonté tous les obstacles pour s’établir en France et fonder une famille, ce qui signifie franchir clandestinement la frontière, sous le feu des carabiniers a-t-il dit, créer une entreprise de maçonnerie avec l’aide d’un compatriote établi avant lui, la faire prospérer grâce à un travail acharné et s’intégrer à la communauté locale. Bien intégré, jusqu’à remporter d’un coup de pouce pas très régulier, il faut le dire, un important appel d’offres. Il s’agissait, suite à une décision (bien mal venue en vérité) de la municipalité, de démolir l’ancienne église de Barcelonnette pour faire place à un parking. Une église multi-centenaire contre un parking !
A côté de mon père il y a, un peu à l’écart, une grande fille, elle aussi vêtue avec soin par sa maman. Visiblement grandie trop vite, le regard volontaire, fermement décidée elle attend son heure. Elle a onze ans et son heure viendra très vite, trop vite, semant la désolation dans cette petite famille à peine assemblée et déjà condamnée.
Une famille comme bien d’autres, sur laquelle s’abat l’orage. La guerre ! Elle coupe les racines, condamne les issues. Tous les parents, proches et lointains, tous les amis restés là-bas, tous les « pays » familiers sont devenus soudain hors d’atteinte. Il faut s’éloigner de cette frontière d’où pourront surgir des diables noirs, sanglés et bottés de cuir, au torse bombé comme un soufflé près à retomber, armés de triques, avant-coureurs d’une police politique redoutable.
Il faut abandonner cette prospérité durement acquise, survivre. Près de Grenoble, à Eybens, ma mère fait des ménages dans la maison bourgeoise voisine, laissant les deux garçons à la garde de leur sœur un peu plus grande. Les trois petits s’occupent, se promènent dans le voisinage. A la maison, ils parlent leur langue, le furlan, et à l’extérieur, pour rester discret, le français. Le père travaille lui aussi, à n’en pas douter, mais il a perdu tout ce qu’il a mis tant d’énergie à construire. Le vin le soutien, bien mal. Il s’intéresse de près à la fille ainée, qui lui ouvre les bras, et le reste. Quand ma mère achève ses ménages, elle retrouve un compagnon violent, qui la frappe après avoir abusé de sa fille.
Carmen
Peut-on reprocher à une gamine de treize ans de détruire une famille ? Elle n’a certainement rien voulu de tel. Elle a tout simplement recherché l’attention du chef de famille, une grande force physique et mentale, en même temps qu’une formidable énergie sensuelle. Un Faune face à une Nymphe qui révélera un appétit sexuel dévorant. Sexe et pouvoir sont toujours associés ; se rapprocher du mâle dominant permettra à cette enfant d’égaler, dépasser même sa mère dans la hiérarchie de ce microcosme familial. Elle la dépassera au-delà de toute espérance.
Pour l’homme c’est autre chose. Il a attiré la mère, profité de sa force morale, à lui, et de sa faiblesse, à elle, pour la retenir. Dans les lettres qu’ils ont échangées on voit d’un côté quelques lignes d’une écriture ferme, impérieuse et de l’autre des pages, hésitantes, presqu’implorantes. Un homme qui exige et une femme qui n’a ni la force ni la volonté ni les moyens de résister. Il sait comment, en quelques mots, la contraindre ; elle ne peut que se débattre, maladroitement.
La fille tombe enceinte, accouche. Elle est encore une gamine qui elle a besoin de sa maman. De l’hôpital elle saisit un méchant morceau de papier et un crayon, elle griffonne :
Chère maman, je suis à l’hôpital j’ai accouché cette nuit à 3h du matin. C’est une fille que j’ai. Quand tu viendras tu m’apporteras …
C’est bien normal, toute maman vient à l’hôpital assister sa fille. Pour la mère, notre mère, c’était trop ; ce jour-là elle rentre à la maison dans une charrette attelée d’un cheval.
Mon père est arrêté et incarcéré pour « Attentat à la pudeur » (sic). Mon frère et moi sommes placés dans une famille d’accueil, sinistre mémoire. Ma sœur ainée fait des ménages dans une famille qui s’intéresse au bébé au point de tenter de « l’escamoter ». La plus jeune, devenue orpheline de père et de mère à neuf ans, séparée de ses petits frères pour qui elle était une seconde mère, est confiée à des fermiers.
Wanda
Elle s’appelait non pas Wanda mais Vittoria Romana, autrement dit victoire de Rome ou plus exactement gloire au Duce. Oui, Wanda est née à une époque où toute l’Italie ne vivait, ne pensait, n’agissait qu’au travers de Mussolini. Les récalcitrants étaient pourchassés ou se terraient ; les autres emplissaient les places de Rome et de toutes les villes et villages d’Italie pour acclamer celui qui relevait la tête, menton prognathe bien haut, et proclamait fièrement : L’Italia farà da sé (l’Italie n’a besoin de personne) ce que certains, nombreux, traduisaient en eux-mêmes par : n’a besoin de personne pour commettre les mêmes crimes que le « Grand Ami » du Nord, du nom de Hitler. Il faut reconnaitre pourtant que les Italiens dans leur ensemble étaient sensibles à cet argument qui stimulait leur amour-propre, alors que pareil pantin grotesque aurait dû les atterrer, eux qui ont pour s’enorgueillir un immense héritage laissé par les grandes civilisations étrusque et romaine, héritage matériel d’une telle richesse que le pays peine à le maintenir en état et aussi héritage immatériel dont nous-mêmes bénéficions. Oui, mais voilà, l’Italie est dépourvue des mines de charbon et de fer qui ont permis le spectaculaire développement industriel de la France et de l’Allemagne. Les Italiens en ont gardé un complexe d’infériorité bien mal placé et dommageable, car ils sont prompts à abandonner leur magnifique langue pour un americano qu’ils balbutient lamentablement.
Après l’accouchement de sa sœur, Wanda voit sa famille volatilisée. La mère décédée, le père emprisonné, elle n’a de nouvelles ni ses deux frères ni de sa sœur et son bébé, envoyés elle ne sait où. Elle est à Eybens, près de Grenoble, dans une ferme où personne ne reste inoccupé ; Wanda garde les vaches et racontera sa terreur de devoir rentrer le troupeau dans la nuit. Elle pense à sa mère, à ses frères et elle pleure ; la fermière la réprimande durement ; elle n’est pas méchante, Madame Mollard, loin de là, mais il ne faudrait pas laisser croire qu’elle maltraite cette petite.
La guerre est terminée mais tout n’est pas réglé. Wanda est apatride car dépourvue de documents d’identité. Elle veut rejoindre l’Italie, quitter ce pays où elle se sent rejetée. On lui reproche, dit-elle, de « manger le pain des Français ». Mais comment franchir la frontière ? Ce sera clandestinement, à pied, dans la neige du Montcenis. Elle est accueillie par sa tante Elisa, qui ne voit pas l’intérêt de l’école et préfère l’employer comme bonniche dans son hôtel.
Wanda est revenue voir Madame Mollard après la guerre. Je n’étais pas présent, hélas, j’avais manqué de connaître de près cet épisode si important de la vie de ma sœur. Ce fut un manquement lourd de conséquence, car il a impacté toute notre vie. Wanda était venue avant tout voir la famille que mon père avait reconstituée et, en premier lieu, le frère qu’elle n’avait pas revu depuis près de quinze ans. Oui mais ce frère était ailleurs, parti en excursion en montagne. Comment ai-je pu manquer ce rendez-vous si important de notre histoire familiale ? Je dois dire qu’alors Wanda n’évoquait rien pour moi. Avais-je fait inconsciemment « l’impasse » sur cette période où j’avais vu disparaitre ma mère ? A n’en pas douter un effacement de mémoire traumatique. Et puis j’avais à construire ma vie, tant à apprendre, les amis et amies ; Barcelonnette était bien loin.
Cette rencontre manquée a été lourde de conséquence ; il s’en est suivit un quiproquo qui a marqué notre vie entière. Pour moi, il était clair que ma seule vue devait évoquer pour Wanda mon père, donc l’homme qui avait entrainé le décès de sa mère en ayant des relations inappropriées avec sa sœur. Je ne pouvais imaginer qu’elle avait gardé toute son estime à l’homme et tenait l’enfant seule responsable. J’ai cru avoir confirmation de sa rancœur à mon égard lorsque je lui ai rendu visite bien des années plus tard. Elle avait à ma vue a fondu en larmes. En réalité ce qui la chagrinait était d’avoir en face d’elle un frère qu’elle attendait depuis si longtemps mais qui se comportait comme un étranger. Je craignais de la blesser par ma seule présence, ce qu’elle prenait pour de la froideur. Il a fallu encore des années pour que le terrible malentendu se dissipe : « Comment as-tu appris que nous étions frère et sœur ? » « Mais je l’ai toujours su ! ».
Nous avons pu enfin, pendant quelques années, savourer pleinement ce lien de sang qui nous unissait. Des années qui se sont comptées sur les doigts d’une main hélas, mais fort heureusement bien plus pour faire connaissance de ses enfants, donc de ma famille italienne. Une véritable renaissance.
Voiron
Retour en arrière. Mon frère n’est plus (1). Je suis dans une institution religieuse que je quitte pour l’hôpital : primo-infection tuberculeuse, puis fièvre typhoïde. A cette époque, après des mois d’hôpital « on se réveillait un matin mort », selon l’expression de mon père, ou guéri. L’équipe médicale au grand complet avait un jour fait cercle autour de moi et ce fut une sœur-infirmière qui me transmit le verdict : « Demain tu iras voir le Petit Jésus ». Le lendemain, je déjouais le pronostic et je me réveillais. Le Petit Jésus m’avait gentiment prié d’attendre. J’en profitais pour me remettre debout et je m’effondrais ; mes jambes ne me tenaient plus. Ainsi, je débutais ma seconde vie à terre.
Après cet épisode suis seul avec mon père qui se déplace de chantiers en chantiers ; je le suis d’école en école. Il me confie quelque temps à de brave gens. Nous sommes à la campagne, en sortant de l’’école je ne rencontre pas un grand chemin de fer, seulement de l’herbe pour nourrir nos lapins. A Noël, j’aurais aimé avoir au moins une orange ; je le demande à mon père, peine perdue.
A table, il n’y avait pas d’eau ; nous buvions donc du vin, et rien d’autre. Je collectionnais les capsules des bouteilles pour en faire des bateaux qui voguaient dans les rigoles provenant de la fontaine publique. J’avais une grande flotte. Nous étions à Voiron. A l’heure du train de Grenoble, je courais à la gare au-devant de mon père. Je courais tout le temps ; que pouvais-je faire d’autre que courir ? Un jour, en débouchant dans une rue je heurtais une voiture au niveau de la roue arrière. Je me relevais heureux d’être indemne quand je vis mon bras ouvert. J’eus peur, je criais. La voiture que j’avais heurtée m’emmena à l’hôpital. Les témoins, qui m’accompagnaient, veillaient à ce que mon sang ne tache pas les sièges. J’en étais indigné : on s’inquiétait de taches, alors que mon sang coulait. J’ai gardé de cette aventure une mauvaise cicatrice et une malformation à la main gauche.
Le dimanche après-midi mon père tapait des barzalette, inspirées de la vie de son village, en Italie, sur sa monumentale Remington, clap ! clap ! clap ! Il m’envoyait au cinéma, une délicate attention que je devais à la tenancière du bistrot du coin, une plantureuse femme esseulée, le mari en prison. Il avait voulu, armé d’un fusil, monter la garde de son potager près duquel s’était installé le cirque Bouglione. Une ombre s’était soudain glissée dans le carré des salades ; allait-elle les dévorer sur pied ? N’écoutant que son courage, notre Tartarin a fait feu dans le noir, tuant un jeune homme qui avait eu la malencontreuse idée de s’écarter pour se soulager.
Nous habitions rue de l’Ancienne Poste, une petite impasse restée inchangée. Auparavant, j’avais été hébergé quelque temps chez des amis italiens. Il nonno, un gros bonhomme chaleureux, avait une propriété à la campagne où, dans une grande chaudière, il teignait et mettait en forme des chapeaux de feutre que sa fille, la mamma, décorait à la mode de l’époque, avec une profusion de rubans, fruits et fleurs artificiels, pour les vendre dans sa boutique de la rue Sermorens. Comme toute mamma qui se respecte, elle s’activait tout le jour en répétant à mi-voix, et sans conviction « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? » Nous vivions dans l’arrière-boutique, une pièce sans fenêtre avec, attenant, un réduit où mon grand copain Joujou, les cheveux gominés, préparait ses vélos pour les courses du dimanche. C’était sa seule occupation, au grand désespoir de sa mère. Moi j’étais ravi, je découvrais comment changer un dérailleur, ou les pignons avant et arrière pour adapter le développement au profil de la prochaine course, redresser une jante, réparer un boyau et bien d’autres choses qui peuvent se cacher derrière un simple vélo. Les dimanches libres, nous parcourions les routes de la région, jusqu’à Lyon et Valence, la Grande Chartreuse comprise, lui avec son vélo de course et moi avec mon vélo tout acier que mon père m’avait contraint d’acheter car telle était sa conception du vélo, solide à toute épreuve et d’un poids conséquent.
Dans la propriété du grand-père était une vigne. Plantée de baco, étalée sur un coteau en pente raide, elle produisait un gros-rouge-qui-tache dont le grand-père était fier. Ce cépage a été par la suite interdit pour des raisons que certains technocrates doivent peut-être connaître, alors qu’on découvre maintenant son intérêt en raison de sa robustesse et sa résistance naturelle aux maladies. L’eau, non buvable, était fournie par une citerne qui recueillait la pluie et on dégringolait la pente pour une belle eau fraîche qui coulait sous les ruines d’un moulin. Quel magnifique terrain de jeu, d’autant plus que les environs étaient plantés de pêchers, je veux dire pêchers des premiers temps, paradis perdu qui nous offrait, à la nuit tombée, des pêches savoureuses, à la peau douce et la chair ferme, au noyau solide, dont nous avons perdu le goût et l’arôme.
J’avais trouvé dans cette belle famille italienne la mère et le frère que je j’avais perdus, le grand-père en plus.
Tout cela n’est plus. Grand-père et parents sont décédés, la maison de campagne a été vendue, les restes du moulin arasés et la belle source claire ensevelie.
Grenoble
J’étais pauvre, mais je ne le savais pas. Pauvres, nous habitions une belle villa dans une zone « chic » de la région grenobloise.
Pour le comprendre il faut un petit retour arrière.
Mon père ouvrier, une famille de quatre enfants, nous étions dans une cité ouvrière en périphérie de la ville de Grenoble.
Nous étions pauvres, donc, mais nous ne le savions pas, car entourés de pauvres. Une société toute entière adaptée à de faibles revenus. Aux heures de pointe, pas d’embouteillages mais des nuées de cyclistes. Cours Berriat, c’était un fleuve qui s’écoulait lentement en formant un tumultueux remous au passage à niveau, bien entendu fermé à moment-là – le pont de l’Estacade n’était pas encore construit. Pas de voitures, pas de taxes sur l’essence, de péages qui surenchérissent régulièrement, pas de gilets jaunes, donc.
Nous allions bien peu dans le centre-ville et ses beaux immeubles bourgeois habités, comme il se doit, par des bourgeois, dont les revenus et le train de vie étaient sans commune mesure aux nôtres. Des riches, pas vraiment, des rupins disait mon père en haussant les épaules, comme parlant d’une espèce un peu exotique.
Les riches, les vrais, étaient comme il se doit au-dessus de nous, c’est-à-dire sur les premiers contreforts des montagnes qui dominent la ville. Leurs « châteaux », de grandes propriétés ceintes de hauts murs, avec au centre un lac, plutôt un étang, étaient signalés de loin par de grands sequoias centenaires, gigantesques. En réalité, quand je vins habiter près d’eux, les châteaux étaient soit vendus soit à vendre, pour des prix plus que modestes.
Mais n’allons pas trop vite.
La cité ouvrière appartenait à la Viscose, autrement dit l’usine de fabrication de la « soie artificielle », faite de bois rendu visqueux, d’où le nom de viscose, pour donner du fil et des tissus soyeux. Nous étions dans de grandes maisons, formant deux ailes, chacune abritant une famille, dans des conditions de confort tout à fait acceptable. J’avais une grande chambre sous les toits, accessible par un petit escalier que seul j’empruntais ; c’était mon domaine. Aux murs j’avais pu agrafer d’immenses affiches : les temps héroïques de l’aviation et du Tour de France, Mermoz, Fausto Coppi, Gino Bartali et autres idoles.
Jusqu’à ce qu’un Français émigré aux Etats-Unis, Eleuthère Irénée du Pont de Nemours, après avoir produit de la poudre à base de nitrocellulose, passe à la chimie de la cellulose puis invente le nylon, appellation qui est un acronyme pied-de nez aux Japonais : « Now You Lose, Old Nippons ». La bataille était planétaire, les femmes ne pouvaient se passer de bas; point de pantalons ni collants ; sous la jupe ou la robe, porte-jarretelles et bas (la belle époque !). Avec le nylon, plus de Viscose. L’usine a fermé, les ouvriers licenciés, avec heureusement une indemnité. Mon père en a profité pour acheter un bout de terrain, qu’il a choisi en hauteur, loin des miasmes de la ville et des émanations chlorées, à l’époque, de l’usine Péchiney de Claix.
Et voilà pourquoi et comment nous nous sommes retrouvés au milieu des nantis.
Le terrain n’était pas tout. Il fallait une maison. Elle fut construite par un travail de tous les jours, et même de nuit ; un travail de fourmis. Dans un premier temps ce fut élément après élément. Le soir après le travail, pour mon père, et le collège, pour moi, nous descendions à la cave fabriquer des moellons de béton. Quelques moellons à la fois, jusqu’à faire de quoi monter une maison. Puis les portes en contreplaqué collé et pressé. La presse c’était moi ; mon lit était posé au-dessus du tas de menuiserie. Ensuite les fenêtres, en cornières métalliques découpées, à la main, à l’équerre et vissées pour former les encadrements. Vissées, voici comment : on perce des trous avec une mauvaise chignole et des mèches éméchées – un comble ! – puis les trous sont filetés à l’aide d’une série de tarauds à passer les uns après les autres. Un travail qui aurait été considérable si nous avions disposé d’outils de qualité mais qui a été, je peux le dire sans emphase, proprement inhumain avec ce bric-à-brac qui nous servait d’outillage. Ne pas dépenser le moindre centime, plutôt se rompre l’échine, et les bras, et les mains, telle était la philosophie de mon père. Une philosophie héritée de ses aïeux, dans la montagne italo-autrichienne. Ils devaient arracher leur vie à une terre impitoyable, en butte au gel, aux tempêtes, avec cette herbe rare qui attendait bien loin là-haut. Une vie de travail acharné da prima il sorgere del sole fino a dopo il tramonto (2). A moins que la neige, qui emplissait les rues jusqu’aux toits des maisons, ne les contraigne au repos forcé. Alors, autour du feu de bois on échangeait potins, nouvelles, légendes, récits de préférence enjolivés, comme dans les tranchées les soldats échangeaient blagues et rires en attendant le prochain déluge d’obus.
Mais revenons à Grenoble. Au moment dont je vous parle, étaient rompus bras et mains ; pour l’échine, nous y arrivons.
Le terrain acquis était, je l’ai dit, sur les hauteurs, donc en pente. Il fallait terrasser. Pour cette occasion mon père fit l’acquisition d’outils neufs, une brouette de bois, une pelle et une pioche, rutilants. Et nous avons pioché, pellé, charrié, un été entier. Quand la terre était sèche, elle se refusait à la pioche mais se prêtait volontiers à la pelle et la brouette. Après une pluie, les difficultés étaient inversées.
Puis vint la construction proprement dite. Cela consistait à enfourcher nos vélos le samedi et dimanche matin tôt, rejoindre la digue du Drac jusqu’à Fontaine. Au passage on voyait des gens s’affairer au bas de la digue. Ici un pont est prévu depuis longtemps dit mon père ; ce sera le pont de Catane. En attendant, il fallait pédaler jusqu’au pont des Arcades de Fontaine, traverser le Drac et revenir dans l’autre sens, attaquer la montée vers Seyssins par la route du bas – celle du haut n’était encore que la voie du tram qui autrefois reliait Grenoble à Villard-de-Lans, une magnifique réalisation hélas disparue. Nos vélos d’acier, d’une solidité à toute épreuve et d’un poids conséquent, il fallait monter à pied, d’abord par la route puis en prenant l’ancien sentier muletier qui arrive droit au village. Près de deux heures avant de pouvoir attaquer le chantier. Idem le soir, dans l’autre sens. Quand le Drac n’était pas trop haut on le traversait vélo sur l’épaule, pour éviter le détour vers Fontaine.
Où croyez-vous que la maison était prévue, près de la route, à portée des camions qui déversaient les matériaux ? Allons donc, bien plutôt tout en haut, toujours plus haut ! Tout était organisé : un énorme treuil de plus d’une tonne – comment était-il arrivé là ? – tirant un wagonnet sur des rails posés à même le terrain. Le treuil pouvait recevoir une courroie provenant d’un moteur, mais de moteur point, seulement une grande manivelle. Le wagonnet était chargé de matériaux au bas de la pente, puis hissé à l’aide de la manivelle, donc. Ce n’était pas tout, lesdits matériaux devaient ensuite être envoyés plus haut, à la pelle – oui, parce que le chantier était encore plus haut ; telle était la devise : toujours plus haut.
Je passerai sur la construction elle-même, qui prit plusieurs années.
Et voilà pourquoi j’étais pauvre et j’habitais une belle villa dans une zone chic de la ville de Grenoble.
Pauvre, non pas indigent, pauvre, comme la grande majorité des Français à cette époque. Le matin vers 7 heures j’attrapais mon vélo, traversais la place du village en ignorant le bus en attente pour Grenoble et dévalais la pente jusqu’à Seyssinet-Pariset, puis je pédalais jusqu’à la Fac.
Le campus de Saint-Martin-d’Hères était alors en construction et nos cours étaient répartis dans différents instituts aux quatre coins de la ville, allant de Joseph Fourier, près de la gare, jusqu’à l’ancien évêché, place Notre-Dame. Nous passions ainsi une bonne partie de la journée à nous balader dans les rues de Grenoble. Je ne me lassais pas du spectacle. Dans l’enfilade de chaque rue une montagne nous attendait. Chacune venait à son tour : le Rachais, la dent de Crolles, Belledonne, Chamrousse, le Taillefer, le Moucherotte et le plateau de Saint-Nizier, puis le tour recommençait, dans la luminosité du matin, la lumière chaude de l’après-midi et enfin le voile envahissant du soir. Selon le jour, elles étaient proches et familières, ou lointaines et hautaines. En hiver, le manteau de brume s’abattait sur elles signalait l’arrivée de la neige, si bien que le lendemain elles réapparaissaient, fières, éblouissantes.
Nous ne craignions pas le froid. Dans notre chambre non chauffée, où notre encrier gelait en hiver, nous dormions sous une légère couverture. Je circulais vêtu d’une mauvaise canadienne dont la vague fourrure semblait venir d’Ecosse (3). Je m’en contentais parfaitement, sauf ce matin de l’année 1956 où dès le village j’étais littéralement mort de froid. Je devais pourtant continuer, le bus était déjà parti et une épreuve de français m’attendait au collègue. En classe, je grelottais à tel point que le stylo m’échappait des mains. La température devait être de l’ordre de -30°, car ce fut l’année où les oliviers ont gelé en Provence (4).
Par la suite j’ai construit, avec l’aide de mon père et de mon frère, une villa encore plus belle et plus en hauteur, par conséquence dans une zone encore plus « chic ». Pourtant j’étais toujours pauvre ! Soyons honnête, j’étais passé dans la classe moyenne, mais en rupture conjugale mon salaire à peine perçu disparaissait aussitôt dans les charges que je devais assumer. Je n’avais pas même de quoi acheter le journal ; je le lisais à la bibliothèque universitaire. Je roulais dans une vieille 2CV à bout de souffle, qui périodiquement rendais son dernier soupir, et que je réussissais à ranimer chaque fois. La 2CV, une merveille de simplicité mécanique, motorisation comprise. Tout était réglable, comme par exemple la hauteur des phares, bien utile quand l’arrière s’affaissait sous la charge – tout se transportait en 2CV ; tout fonctionnait ainsi, manuellement, jusqu’aux essuie-glace. Et un système de refroidissement simplissime: un ventilateur.
Je pouvais tout réparer, même le moteur, que je sortais à l’aide d’un petit palan. J’étais allé jusqu’à changer l’embiellage. Ceux qui connaissent un peu la mécanique savent ce que cela veut dire (je n’ose imaginer ce que serait de présenter cette guimbarde à un contrôle technique). Elle était parfaitement adaptée aux besoins des Français, à la ville comme à la campagne.
Je me plais à comparer la réponse apportée à cette situation sociale, en France par la famille Citroën, même si elle n’était plus aux commandes, et en Italie par la famille Agnelli, qui elle est restée en place. D’un côté la 2CV, un véhicule d’un grand volume utile mais rudimentaire et très fonctionnel, et de l’autre la Fiat 500, une « vraie » voiture, avec une belle carrosserie, de belles finitions. En contrepartie une taille minuscule, qui ne dissuadait pas les familles nombreuses italiennes de s’y entasser joyeusement. Dans les deux cas, un excellent moteur.
La neige, Grenoble vit à son rythme. La couche atteignait couramment un à deux mètres – chose qui n’est plus : le réchauffement climatique n’est pas un vain mot (5). Avec de mauvais skis, on grimpait au sommet d’un immense champ et on dévalait la pente raide, tout schuss, raides comme des piquets, pour atterrir dans un épais buisson de ronces qui nous servait d’amortisseur.
Il suffit de jeter un coup d’œil sur les montagnes environnantes pour tout savoir de l’enneigement : superficiel et peu skiable, ou profond et poudreux, ou bien une neige glacée en surface et légère en dessous. Surtout, a-t-on vu se déposer une bonne sous-couche, prémisse à une belle glisse ? L’ennemi n°1 est le sirocco, chaud en altitude, il dépose une couche rougeâtre de sable saharien, laissant après lui une neige détrempée, lourde, où les skis au lieu de glisser s’enfoncent profondément et qu’il faut extirper, chargés « d’une tonne de soupe ».
S’il arrive par malheur un hiver sans neige, la ville est à l’arrêt ; un deuil collectif.
Le campus de Saint-Martin d’Hères est au pied du massif de Belledonne, si bien que, quand l’enneigement s’y prête, il est possible de partir avant le lever du jour pour aller faire un sommet en skis et être au retour au labo, certes pas très tôt mais à une heure décente pour commencer la journée.
Certains – des Parisiens, bien évidemment – osent prétendre, avec obstination, que les montagnes « cachent la vue ». Quelle aberration. Comment ne pas voir, surtout dans un site privilégié comme Grenoble, le spectacle permanent, sans cesse renouvelé, de jour en jour, d’heure en heure, qu’offrent les montagnes, un spectacle vivant, qui fourmille d’acteurs et de scènes variées. Quelle vue peut au contraire offrir un terrain plat, où l’œil butte sur le moindre obstacle. Sur l’Ile de Ré, par exemple, un terrain rigoureusement plat, les arbres paraissent curieusement former une ronde autour de nous ; c’est que le regard ne peut aller au-delà du premier tronc, en même temps que l’absence de repère fait que tous semblent être à la même distance. Ces détracteurs ne diront pas « je vais en montagne » mais « à la montagne », comme si la montagne était unique, uniforme, monobloc, sans détails ni particularités.
Ainsi va la vie grenobloise.
Seyssins
« Alors, tu vas toujours aux écoles ? » me demandait notre voisin fermier, le père Bourdat, de cette voix forte et chaude qui faisait obéir les bêtes, comme il aurait dit « Alors tu fais toujours le clown dans un cirque ? ». Quoique, le cirque, on connait, il passe de temps en temps, bruyamment, l’école aussi on connait, elle est dans le bâtiment de la mairie, tous les gamins y vont ou y sont allés, mais « les écoles » c’est bien autre chose et c’est bien étrange. Quand j’étais à l’école, justement, je passais à la ferme pour le lait, tous les jours à l’heure dite, par contre avec « les écoles » c’était moins facile, je n’étais plus aussi disponible. Il fallait déposer le bidon d’aluminium, avec son couvercle retenu par une chainette, avant la traite, impérativement, puis le reprendre plus tard, plein d’un bon lait fraichement « tiré ». Le rituel était imposé, immuable : le lait frais était d’abord distribué dans les récipients déposés par les voisins. Le reste, dans le grand bidon du laitier, était suspendu par une corde dans l’eau fraîche de la fontaine ; il n’était plus alors question d’y toucher, tant pis pour les retardataires.
Il y avait aussi les deux sœurs Grasset, l’une devenue madame Bourdat ; l’autre était, comme dans la chanson d’Yves Montant, Paulette, pour nous Mademoiselle Paulette. J’ai peu de souvenir de leurs parents. J’avais fait appel au père Grasset pour greffer un cerisier qui avait poussé dans notre jardin. Un cerisier sauvage, donc. Greffer un arbre est tout un art. Il faut prélever un bourgeon sur un arbre qui donne de bons fruits, c’est le greffon, et le faire se développer sur un pied sauvage, le porte-greffe. Mais attention, prélever le greffon en hiver et le garder au froid, pour qu’il reste dormant, jusqu’au printemps. Attendre que le porte-greffe entame une poussée de sève et insérer le greffon. Il y a de nombreuses techniques d’insertion qu’il est inutile de détailler ici.
Au décès des parents il fallait un homme pour maintenir la ferme, alors une des sœurs s’est mariée au père Bourdat. Dans ce cas l’usage veut que l’autre sœur parte se marier ailleurs, mais Paulette a voulu rester là où elle était née et avait grandi. Le prix à payer était de rester célibataire, ce qu’elle a fait. Nous étions amis. Pour moi, cette ferme c’était le père Bourdat et Paulette. Pousser le grand portail, entrer dans la cour puis, quelquefois, dans la cuisine surchauffée par le poêle à bois, nous projetait tout d’un coup dans une autre planète.
Une planète qui n’est plus. La ferme a fait place à des immeubles, pour logements sociaux faut-il préciser.
- Voir : http://levantin.com/mort-de-mon-frere/
- Avant le lever du soleil jusqu’après son coucher.
- Le ruban Scotch porte a reçu cette appellation car au départ il est chichement encollé.
- Les oliviers actuels sont de rejetons partis des souches.
- Le réchauffement climatique est bien réel ; il a débuté il y a près de 10.000 ans et se poursuivra encore pendant quelques milliers d’année, avant que la tendance ne s’inverse. Les efforts pour freiner cette évolution sont touchants de naïveté (néanmoins bénéfiques pour la santé de tous les êtres vivants de la planète).


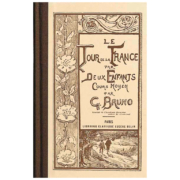





I was excited to discover this website. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you book-marked to look at new things on your website.