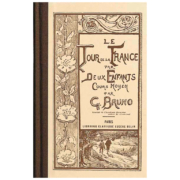Dans la famille Trillat, je demande :
Les hauteurs qui dominent Grenoble, les coteaux au pied du Moucherotte sur les communes de Seyssinet et Seyssins, comme les premiers contreforts du massif de la Grande Chartreuse, ont été investis par les grands bourgeois grenoblois. Ils y ont établi des domaines, tous établis sur le même modèle : un « château » au sein d’un parc avec grands arbres et plan d’eau, le tout ceint de hauts murs de pierres de taille. Pour exploiter les terrains environnants, une ferme.
Ces grands bourgeois, généralement des commerçants, sont devenus industriels et ont déserté ces domaines. Les châteaux ont alors connu des fortunes diverses ; certains sont tombés en décrépitude tandis que d’autres ont fait le bonheur d’une nouvelle génération de bourgeois, ceux-là du secteur tertiaire. On a vu une famille incapable de suivre cette évolution et, privée de ressources, dans l’impossibilité de faire face à sa subsistance comme à l’entretien du bâtiment, se replier sur elle-même et vivre à l’intérieur du château, son ancienne gloire, comme des nomades sous une tente.
Les terrains agricoles ont été progressivement lotis, avant de se transformer en zones commerciales.
Quand Marcel Trillat, mon copain de collège, m’invita à participer aux moissons, sa famille exploitait encore la ferme Percevalière. Une ferme familiale, une quinzaine de vaches, quelques hectares de blé et de fourrage, de modestes bâtiments en U : une habitation surmontée d’une sorte de petite tour carrée, un bâtiment ouvert qui servait de remise, une étable avec grange attenante, le tout géré par une famille harmonieuse et industrieuse. Elle irradiait un bonheur tranquille dans lequel je m’étais glissé.
Le père
Quand j’arrivais à la ferme, le père Trillat fauchait les blés, perché sur un engin que tirait Papillon, le cheval de la famille. Une faucheuse qui appartiendrait aujourd’hui au musée de la paysannerie. Il nous revenait ensuite de rassembler les blés coupés en petites gerbes, adroitement liées par quelques tiges, une technique que j’ai dû apprendre rapidement. Les gerbes étaient ensuite assemblées en meules, têtes en l’air pour que les épis ne soient pas au contact du sol, en attendant l’arrivée de la batteuse.
C’était avant les moissonneuses-batteuses, qui allaient intégrer toutes les opérations : fauchage, battage, tamisage et compactage de la paille en bottes – quand tout allait bien, ce qui n’était pas toujours le cas avec les premières machines.
Avant-avant, pas de faucheuse ni de cheval, le blé était coupé à la faucille. J’ai vu de vieux paysans le pratiquer encore dans les Alpes, au début des années 60. Il fallait plusieurs jours à deux personnes pour faucher un champ de taille moyenne. Le blé était ensuite battu sur une aire tapissée d’immenses lauzes. Chaque ferme en possédait une. Le blé, mélangé à de la paille pour éviter que le grain soit écrasé, était foulé au moyen d’une grosse pierre taillée en cylindre, tirée par un cheval ou des bœufs.
Revenons à la moissonneuse-batteuse. Le père Trillat avait tenté de persuader ses voisins d’en acheter une en commun. Oui, mais ses voisins étaient des paysans, ce qui va de soi, individualistes et méfiants, c’était leur moindre défaut. Le temps des moissons est très court, les blés mûrs ne peuvent rester longtemps sur pieds et sont à la merci d’un orage qui coucherait les lourds épis, alors acheter une moissonneuse, oui, mais qui va moissonner en premier ? Les tractations ont échoué sur ce point.
Ceci jusqu’à ce que les moissonneuses-batteuses soient gérées par des entreprises prestataires. Les machines actuelles ont une trémie pour déverser le grain dans une remorque qui stationne en périphérie du champ. A mon époque des sacs de jute remplissaient cet office. Voici donc Dédé, le cousin dont je parlerais plus tard, sur la machine, emplissant les sacs de grain, en prenant un malin plaisir à les remplir jusqu’au bout, à la limite de pourvoir les fermer. Des sacs de 80 kg que lui, d’une force herculéenne, pouvait manipuler facilement, sachant que pour moi, et d’autres, ce sera une tout autre affaire. Ce n’était pas tout, la dernière étape consistait à les vider dans le silo à grain. Oui, mais le silo était à l’étage et pour y accéder une planche inclinée, bien entendu étroite et bien entendu instable. Me voici donc avec un de ces énormes sacs sur un dos tendu à l’extrême, à la limite de casser comme du bois sec, en équilibre sur cette planche traitresse qui vacillait sous mon poids ajouté à celui de mon chargement et dont le moindre mouvement me projetait à la limite de la rupture, le tout sous l’œil goguenard de Dédé. J’aurais pu, évidemment, lui abandonner cette besogne, mais c’était avouer ma faiblesse. Pas question, plutôt risquer de se rompre l’échine !
Le père Trillat avait « fait » la guerre de 14. On l’avait envoyé au casse-pipe comme la plupart des jeunes français et, d’une voie calme, il nous racontait les horreurs qu’il avait connues. Certaines nuits, disait-ils, les obus tombaient sans discontinuer, pilonnant tout. Impossible d’en échapper ! Seul espoir, pensaient ces pauvres gars, il y a peu de chance de deux obus tombent exactement au même endroit. Alors, dès qu’un obus tombait, ils se précipitaient dans le trou formé, en guettant l’obus suivant pour répéter l’opération. Jusqu’au matin ! Je passe sur le reste, les gaz et autres. On ne sort pas indemne de telles épreuves. Le père Trillat était affaibli, ce qui ne l’empêchait pas de gérer la ferme avec rigueur, ni d’avoir l’œil à tout, y compris à ce qui se passait sous les feuillages des environs ou dans le château. Voyant des amoureux se glisser furtivement le long des haies : « il va lui faire voir les feuilles à l’envers ! ». Venant du château, il nous faisait part de scènes plus scabreuses, toujours pince-sans-rire.
Un jour avec Marcel nous avons failli causer la perte du troupeau. Nous avions gardé les vaches comme bien souvent, plus exactement nous avions longuement discuté pendant que les vaches broutaient tranquillement, mais au retour à la ferme, nous voyant arriver de loin, le père Trillat toujours aux aguets s’est écrié : « catastrophe, elles sont gonflées ». Stupeur, nous n’avions rien vu. Un champ de luzerne était à proximité et les vaches sont allées tranquillement brouter le sommet de ces tiges tendres et savoureuses. Problème, une fois ingurgitée, cette luzerne fraiche fermente exagérément, produisant des gaz qui gonflent la panse au point d’étouffer l’animal. Tout le troupeau était en voie d’être irrémédiablement perdu : une vache qui meurt dans ces conditions est impropre à la consommation ; elle est destinée à l’équarrissage.
Seule solution, surprenante, pour tenter de sauver les bêtes : les attacher des arbres, leur maintenir la gueule ouverte par un bâton et leur faire ingurgiter … des litres de gasoil. Ce liquide écœurant a pour but de les faire éructer et donc évacuer les gaz de la panse. Les vaches font des efforts désespérés pour se libérer de ce liquide nauséabond et il faut les aider en massant avec force l’arrière de la cage thoracique, seul espace de l’abdomen accessible. Masser avec l’énergie du désespoir, en fêtant chaque rot comme une victoire. Nos efforts ont duré une bonne partie de la nuit. Au matin les vaches étaient sauvées !
C’est finalement un cancer, à n’en pas douter la conséquence de ce qu’il avait subi, qui emportera le brave père Trillat.
La mère
La discrète Madame Trillat était la maman de tous ceux qui, nombreux, passaient par là. Un harmonieux visage ovale, des cheveux grisonnants légèrement ondulés, noués sur la nuque, elle est ainsi figée dans ma mémoire, encadrée dans la petite fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour. Tout en vaquant aux travaux ménagers, de ce poste d’observation privilégié, elle suivait tous les mouvements de la ferme. Une voix douce, qu’on entendait peu, mais qui m’aurait tellement manqué. Je dis m’aurait, car à son décès, je n’ai pas eu le courage d’affronter une ferme où elle n’était plus et j’ai dès lors définitivement cessé de m’y rendre.
La fille
Marthe était la cheville ouvrière de Percevalière.
Le matin tôt, Marthe, juchée sur une charrette tirée par Papillon, un papillon d’environ une tonne, allait livrer le lait au village. Il fallait bien cette masse de muscles pour escalader avec cet équipage la rue de l’Eglise. Ce lait, Marthe l’avait trait le matin-même, après avoir nettoyé l’étable, évacué le fumier, remplacé par de la paille fraîche.
Puis est venue la 2CV fourgonnette. Puis Papillon est mort dans une terrible nuit où d’insupportables souffrances jetaient cette énorme masse contre les murs, qui en tremblaient. Jusqu’au matin, Marthe est restée là, terrifiée, impuissante, désespérée.
Marthe était partout. Toujours à grands pas, elle traversait la cour, de la cuisine à l’étable, à la grange, au bassin. Elle moulait le grain pour les vaches, les soignait. Elle était aux champs, au potager, toujours avec le même entrain, la même énergie.
Marthe, c’étaient de grands plats de gratin, de clafoutis, de grandes miches de pain, qu’elle pétrissait elle-même, avec la farine de la ferme et qu’elle cuisait dans le four où brulaient d’énormes fagots – tout était grand à Percevalière. Quand il s‘agissait de manger, une grande pièce, une grande table où pouvaient prendre place au moins vingt affamés par les travaux de la ferme. Se succédaient casse-croûtes et repas, dès 6 heures, puis 10 heures, midi, etc.. Marthe cuisinait, servait, desservait, avec un mot pour chacun.
Cette grande table était aussi le pétrin. Il fallait bien les bras de Marthe pour malaxer une telle masse de pâte. Régulièrement, devant cette espèce de barbe-à-papa que nous servent les « boulangers » je me promettais de demander à Marthe comment elle pouvait bien faire un aussi bon pain, promesse que je n’ai jamais tenue.
Marthe, c’étaient des balades en montagne, avec d’incroyables casse-croûtes, où sortaient du sac de belles miches, bien sûr, des conserves de toutes sortes, faites par Marthe, et même un gros bocal de cornichons, passé directement du placard de la cuisine au sac. Marthe ne savait rien faire de petit.
Il est des drames qu’il est possible de surmonter, que l’on doit accepter parce qu’ils sont dans la nature des choses, parce que le monde est ainsi fait. Il en est d’autres qui sont trop injustes. Marthe a vu ses bêtes brûlées vives dans l’incendie de sa ferme. Les flammes l’ont atteinte elle aussi, dans sa chair. Elle n’a pas survécu à ses brûlures. Elle est morte d’avoir été trop accueillante, de trop de chaleur qu’elle dispensait à tous, hommes et bêtes, familiers mais aussi – pour son malheur- marginaux de tous poils.
Dédé
Le cousin Dédé était le costaud de la famille. Une jambe raide et des bras noueux, Dédé était de tous les travaux de force, avec aux lèvres un soupçon de sourire narquois devant nos efforts pour s’emparer d’une fourche et tenter de lui venir en aide. D’où venait-il, pourquoi cette infirmité, je ne l’ai jamais su. Peut-être l’ai-je demandé, mais je n’ai gardé aucun souvenir de la réponse, si réponse il y eut. Il était le cousin et cela suffisait.
Raide comme il était, il m’avait appris à skier. Plus exactement, quand la neige s’y prêtait, nous grimpions au sommet d’un immense champ en forte pente que Dédé dévalait droit sur ses skis, incapable d’esquisser le moindre mouvement, moi derrière, jusqu’au bas du vallon où un épais buisson épineux sous servait d’amortisseur. Par la suite, en stations, j’ai gardé de cet « enseignement » une propension à dévaler les pistes selon la selon la ligne de plus forte pente, pour ne dévier de la trajectoire qu’en cas d’absolue nécessité.
Le fils
Marcel Trillat n’est plus. Je dois le répéter pour m’en persuader.
Un phare s’est éteint dans ma vie, un phare qui m’a longtemps guidé, moi qui avais tout à apprendre ; il m’a montré tant de voies en même temps qu’il m’a révélé tant d’écueils.
Je lui dois tant. Qu’aurait été ma vie si je ne l’avais pas suivi à Lyon, là où tout a commencé pour moi, là où j’ai tout appris, entrepris.
Le présent nous le vivions ensemble, le même modeste appartement sur les pentes de la Croix Rousse ou sur les bords de Saône, les mêmes repas au resto-U ou dans les bouchons, à l’époque authentiques, les mêmes sorties au théâtre de Villeurbanne, chez Roger Planchon, les mêmes cafés place des Terreaux le samedi, pour assister aux matchs de rugby commentés par Roger Couderc.
L’avenir, nous le construisions ensemble. Il serait libraire et moi j’aurai un atelier de photographe attenant. Ma vie prenait ainsi forme, s’organisait là, aux côtés, dans le sillage de Marcel Trillat.
En fin de compte ce ne fut notre chemin ni à l’un ni à l’autre. Une circonstance favorable lui a permis d’intégrer l’équipe de Cinq Colonnes à la Une de Pierre Desgraupes et donner corps à sa vocation de journaliste. Pour moi, une autre circonstance favorable m’a permis d’intégrer l’université et donner corps à ma vocation de chercheur scientifique.
Marcel, c’était une vie d’éternelles discussion, clope au bec, autour d’une bonne table et de bonnes bouteilles. Très sympathique mais pas très hygiénique tout cela ; je lui en avais fait la remarque, ce qu’il avait écarté avec dédain. Une cardiologue lui avait sauvé la vie une première fois, in extremis, en lui installant d’autorité un pacemaker.
Que s’est-il passé par la suite, je ne sais pas. Je m’étais éloigné, cependant je voyais toujours une lumière, au loin, une toute petite lumière, et c’était suffisant.
Cette petite lumière n’est plus ; elle a fait place à un immense trou noir.