Ce fut une terrifiante lueur orange. Elle n’a sans doute duré qu’une fraction de seconde, mais devant mes yeux elle luit a jamais, toujours aussi brutale, aussi féroce, aussi cruellement absurde. Je n’ai perçu aucun bruit, seulement la lueur : lorsqu’on est au sein même d’une explosion, on n’en perçoit pas le bruit. Tous ceux qui ont connu cela et en ont survécu le confirment. Ce qui est resté dans la mémoire des survivants d’Hiroshima, c’est « Le Grand Eclair », et rien d’autre. C’est dans le plus grand silence que, dans leur mémoire, l’ouragan fabuleux balaie sans répit leur ville et fait s’écrouler les immeubles sur eux, comme dans un film muet, projeté au ralenti.
Je somnolais sur mon lit, où m’avait poussé un vague mal de tête. La formidable lueur, s’engouffrant par la porte restée ouverte, m’a fait bondir. Je me suis rué dans la pièce attenante où mon frère, en compagnie de Pierre, était occupé a démonter le « détonateur ».
Nous étions en mai 1947 ; l’école était fermée pour cause d’Ascension, une raison qui me paraissait bien obscure. Mon frère et moi, seuls pour la journée dans notre maison perdue dans les vignes, nous avions attendu impatiemment le début de l’après-midi, pour aller voir les copains au village.
Ce jour de congé pour cause d’Ascension, nous avons rencontré Pierre, qui nous a aussitôt entraînés vers une sensationnelle découverte. Plutôt, il a entrainé Bruno, moi je n’ai fait que suivre, vers le creux d’un mur délabré, où il avait dissimulé une chose vert-grisâtre, grosse comme le poing d’un homme, dont la surface dessinait des carreaux réguliers. II l’a présentée fièrement : « Regardez! un détonateur » – en fait une grenade. C’était à coup sûr quelque chose d’important, qui avait servi à la guerre, c’était dire! Ils décidèrent immédiatement de 1’emmener chez nous, pour voir ce qu’il y avait dedans.
Pour être franc, ce machin ne m’emballait pas. J’aurais volontiers proposé de le remettre là où il était, et d’aller se balader dans les coteaux. J’avais mon idée. II faisait si beau et tellement chaud, déjà. Dans les murs de pierres qui sillonnaient les vignes, les lézards devaient être de retour. Ils devaient se prélasser de nouveau au soleil, à la fois si indolents et si vifs. Quelle belle chasse nous attendait. J’avoue que c’était, avec l’attaque des nids de guêpes, un de mes plaisirs favoris.
Je ne chassais pas le lézard par cruauté, loin de là, mais pour la difficulté de la chose. Atteindre un lézard d’un jet de pierre est une prouesse : non seulement la cible est petite, mais elle esquive le projectile avec une rapidité et une précision diaboliques. L’animal peut se permettre d’attendre, immobile, que la pierre – lancée à quelle vitesse ! – parvienne à quelques centimètres seulement de lui, avant de bouger. Pourtant, quand elle atteint le mur le lézard n’est plus là !
L’esquive est souvent narquoise, condescendante même car, après avoir évité le tir, c’est sans hâte excessive que l’animal se glisse à l’abri, entre deux blocs. De là, il vous nargue encore, assez dégagé pour voir et être vu, mais trop dissimulé pour être atteint. Jetez-lui une pierre, elle pourra s’écraser a quelques millimètres de lui sans qu’il daigne seulement broncher. Essayer de l’atteindre avec un bâton, il reculera mollement, toujours hors d’atteinte. Avouez qu’il y a de quoi enrager !
Le jeu était terriblement excitant. Paradoxalement, ce qui gâchait un peu mon plaisir était que, parfois, j’en touchais un. Après avoir crié victoire, j’étais triste et honteux devant cette pauvre chose désarticulée et sanguinolente, agitée d’interminables soubresauts désordonnés. J’étais furieux aussi, avec le sentiment d’avoir été lâchement abandonné par un compagnon de jeu.
Mais, ce jour-là, je n’ai pas proposé de chasse au lézard : je n’aurais pas été entendu. Le « détonateur » avait disparu dans la poche de mon frère, et nous nous dirigions d’un bon pas vers notre maison.
Nous nous sommes installés près de la fenêtre ouverte, bien au soleil. Mon frère dirigeait les opérations. II a pris le marteau de cordonnier, celui qui était entièrement métallique, tout d’une pièce, et s’est mis à taper de toutes ses forces sur 1’engin verdâtre, pour le contraindre à révéler son intérieur.
Une poudre grise a commencé de filtrer. Nous ne pouvions pas savoir, ni mon frère, ni Pierre, ni moi, que des gens très consciencieux et très compétents avaient composé cette poudre avec le plus grand soin, pour qu’elle explose avec le plus de force possible. D’autres personnes, tout aussi consciencieuses et compétentes avaient, elles, soigneusement étudié l’enveloppe métallique, et avaient fort intelligemment dessiné les petits carreaux, pour que le métal soit bien pulvérisé en une multitude d’éclats bien coupants, qui s’enfoncent bien, en tournoyant, dans les chairs tendres, afin de les déchiqueter efficacement. Ils avaient procédé a de nombreux essais, qui avaient été analysés et critiqués, de manière que le produit élaboré soit entièrement satisfaisant. Et il 1’était !
Nous ne savions rien, non plus, du savant mécanisme qui allait déclencher 1’apocalypse, au bon moment.
Moi qui, pourtant, me suis tant régalé à démonter vieux réveils, postes de TSF éventrés et autres, je n’attendais rien de ce machin antipathique. Je me sentais fatigué Je suis passé dans la pièce d’à côté, et je me suis allongé sur mon lit.
C’est alors que la lueur orange me fit bondir. La pièce que je venais de quitter était plongée dans l’obscurité ; la fumée, sans doute. La voix de mon frère m’implorait, venant du fond de la pièce : « Sors-moi d’ici, vite, sors-moi d’ici » !
Pierre, où est Pierre ? J’appelle, je me rue au-dehors à sa recherche. Je surgis sur le petit perron de 1’entrée, inondé du soleil de ce beau jour de mai. Tout autour, la vigne, dont les jeunes pousses s’épanouissent dans la tiédeur printanière. Au loin est le village d’Arbin avec, un peu à l’écart, sur un monticule, la demeure du Comte, notre propriétaire.
Sur le chemin de terre qui va droit au village, Pierre court comme un fou. II est loin déjà. Je 1’appelle, je crie avec l’énergie du désespoir. « Pierre ! Pierre ! reviens ! » Mais Pierre ne reviendra pas. Je devrai affronter seul ce qui m’attend à l’intérieur.
« Sors-moi d’ici, vite, le plafond va tomber ! ».
Non, il ne va pas tomber, le plafond. Je vais pourtant te tirer de là, puisque tu y tiens tant ! Je saisis les poignets tendus vers moi, et je tire tout doucement. Les poignets sont poisseux. En arrivant dans la pièce de l’entrée, je m’aperçois qu’il n’y a plus de mains. Mon frère est presque entièrement dévêtu, et tout son corps est criblé d’énormes d’entailles. En glissant sur le plancher, il laisse une large trace humide.
Nous arrivons près de la porte ; inutile d’aller plus loin. Mon frère ne dit plus rien. Je reste prostré près de lui. Je regarde sans comprendre la cuisse emportée. C’est un gros morceau de viande rose, toute pâle, comme chez le boucher, avec un os au milieu, bien lisse et bien nacre.
Des gens sont venus, m’ont emporté dehors. Puis mon père est arrivé. II a jeté sa bicyclette rouge à terre. La roue s’est mise à tourner. Elle tourne toujours.
Le soir, j’ai mangé des œufs au plat, chez des amis. Les œufs étaient écœurants : le blanc n’était pas cuit.
C’est le lendemain que j’ai appris la mort de mon frère. Nous marchions sur une petite route, avec mon père. II s’est assis sur une borne, pour me le dire.
Qu’est-ce que la mort, pour un enfant de huit ans ? II m’a fallu longtemps pour le comprendre. Mon frère était mort, et je devais aller tout seul à la pêche aux grenouilles. Je devais m’occuper de tout et, seul, trouver mon chemin dans la colline. Quand je rencontrais une vipère, lovée au pied d’un mur, elle ne pointait sa tête menaçante que vers moi, et il n’y avait que moi pour décider de partir en courant, ou bien de passer le chemin en faisant mine de l’ignorer. Je n’avais plus personne à suivre.
Mon frère n’apparaissait plus que dans mes rêves. II vint de moins en moins souvent, puis plus du tout, et son visage a disparu.
Il était mort.
Bruno, ce 28 mai 1947, jour sinistre où ta vie s’est arrêtée, tu avais neuf ans et quelques mois ; je te suivais d’un an. Tu as été mon seul frère authentique, génétiquement je veux dire, car nous n’avons pu ni l’un ni l’autre connaître Henri, qui nous avait précédé. A partir de quel âge deux frères peuvent-ils communiquer, à partir de trois ans, sans doute. Nous aurions donc pu échanger, comme le font deux frères, pendant cinq ans, au moins. Tu étais mon grand frère, donc mon modèle à suivre. J’aurais dû dès mon plus jeune âge t’observer, t’imiter, et un peu plus tard demander ton avis, te faire part de ce qui me plait et ne me plait pas, et réciproquement. Or, je n’en ai aucun souvenir d’un quelconque échange entre nous. En témoigne ce jour fatidique où notre copain Pierre était venu t’annoncer la découverte sensationnelle d’un « détonateur », en réalité une grenade défensive, une grenade qui tue, j’étais tenu en-dehors. D’après quelques dessins qu’il a pu laisser, il est clair que Bruno avait un tempérament d’artiste, surtout pas bricoleur, aussi je ne m’explique pas qu’il a pu s’intéresser à cet engin, au point de vouloir le démonter. Il l’a fait, et de la façon la plus absurde, en tapant dessus avec un marteau. En réalité, quelle que soit la méthode, l’issue était fatale. Ce sont des maux de tête, ajoutés au peu d’intérêt que je portais à la chose, qui m’ont conduit à quitter la pièce pour m’allonger sur mon lit. A la manière du tricheur de Sacha Guitry, sauvé parce que puni et privé de champignons, j’ai eu la vie sauve grâce à une santé fragile.
Je n’ai de Bruno aucune photo non plus, qui aurait pu témoigner de la vie quotidienne de deux jeunes frères. Alors que nous sommes maintenant noyés sous les images, que les moindres faits et gestes de chacun est fixé par tous les appareils possibles et imaginables qui nous entourent, il fallait à l’époque se ranger devant l’objectif d’un photographe professionnel, ce qui avait le double inconvénient d’être peu fréquent et ne pas rendre compte de la vie quotidienne. C’est ainsi que m’est parvenue la seule image de Bruno. Il est âgé de dix-huit mois, dans les bras de notre père. Pour être éloignée de la vie quotidienne, cette image est néanmoins parlante. Elle nous dit que Bruno était peu expansif, jusqu’à être apparemment enfermé sur lui-même. Ceci explique sans doute cela. Comme je suis moi-même très nettement introverti, la communication entre nous devait être réduite à sa plus simple expression. Nous avons semble-t-il vécu côte à côte sans véritablement nous rencontrer.





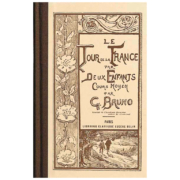


Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!