Ariane Ascaride appelait son père pa’ (1) ; moi aussi. Il était émigré italien, le mien aussi. Elle était à Marseille, moi aussi ; enfin, j’y suis venu plus tard, alors elle était déjà « montée » à Paris. Personnellement, je n’ai jamais cédé aux sirènes parisiennes. Ai-je eu tort ?
Les lettres d’Ariane à son père me ressemblent beaucoup. J’aurais pu les écrire, si j’avais eu son talent. D’ailleurs, pour certaines il me semble les avoir écrites et je m’étonne presque de les voir formulées au féminin.
Mais bon, je ne suis pas Ariane Ascaride et son père n’est pas le mien, loin s’en faut. Chez nous, pas de tendresse futile mais une sobriété de mots et de gestes propres aux survivants que nous étions. La guerre et les épreuves n’avaient laissé de place en nous qu’au fondamental. Quand la mort frappe si près que notre sang se fige, reste la volonté farouche de préserver cette précieuse et fragile vie en nous, en même temps qu’un lien indéfectible père-fils, sans fioriture, sans paroles inutiles. D’où le pa’.
Mon père ne m’a rien appris, c’est dire qu’il m’a laissé libre de tout apprendre. Pas de morale, pas de croyance, pas de préjugé – merci pa’ – seulement l’histoire de son pays. Non pas l’histoire de l’Italie, mais du pays où il est né et a grandi. Cette histoire dont nous avons tous besoin pour nous former et donner un sens à notre propre vie. « Il faut un lieu pour faire une famille » nous dit Caroline Bongrand (2).
« Ton père est un homme droit » m’avait dit un ami, qui pourtant le connaissait si peu. J’en fus surpris, à tort je dus le reconnaitre. Un homme droit, mon père ? Oui mais c’est bien sûr, aucune propension à ployer l’échine devant quiconque, dans aucune circonstance et à n’importe quel prix.
Droit ne veut pas dire sans défauts. Il y avait deux personnes en lui, un homme, le compagnon de ma mère, et mon père. Les deux avaient d’énormes défaut et d’immenses qualités. En réalité les défauts étaient surtout chez le premier et les qualités chez le second, ce qui va de soi.
Défaut est un bien faible mot. Il était violent, et irresponsable. Au point d’entraîner le décès de ma mère, non pas par sa violence mais par son irresponsabilité, plus exactement par sa violence conjuguée à son irresponsabilité (3). Irresponsable ? Bizarre, vous avez dit bizarre ? Oui, bizarre, l’homme que j’ai connu faisait au contraire preuve d’une grande responsabilité. Il était le père nourricier, le pélican qui donnerait ses tripes et son sang pour nourrir sa famille. Sans doute avait-il tiré la leçon de ses errements passés.
J’y pense, il y avait en fait trois personnes chez mon père. Bien plus, en réalité. Une forte personnalité peut-elle ne pas avoir de nombreuses facettes ?
Il y eut d’abord un enfant sage, né de père inconnu – tiens ! – un enfant de chœur qui officiait sagement à l’église de Sutrio, Sudri dans la langue de ce pays des Alpes septentrionales, à la frontière autrichienne. Puis un adolescent un peu sauvage. Seul avec sa mère, peu présente car elle passait ses jours, et ses nuits, à nourrir autrui : elle était la boulangère. Peu présente dans son foyer donc, mais au centre de la vie du village. Peu présente, mais mon père pouvait la voir à tout moment, il lui suffisait de pousser la porte de la boutique. Lui, parmi ces paysans montagnards, acharnés à extraire leur vie de cette terre aride qui se dérobait à leurs efforts, n’avait personne avec qui communiquer, pas de vrais échanges. Alors il se fit le spectateur de cette communauté fermée sur elle-même. Ici, comme dans les villages voisins, à l’identique, il était hors de question de nouer des liens à l’extérieur, ce qui se reflète dans les patronymes, en nombre très limité dans chacun d’eux. Une vie collective où personne n’était seul. Il y avait les plus riches, qui possédaient une terre et les plus pauvres, qui ne possédaient rien, mais personne n’était à l’écart ; une vie collective où tous vivaient en harmonie dans le labeur, mis à part naturellement les inévitables rivalités et tiraillements, bien peu de choses face au déchainement périodique des éléments, grands froids, tempêtes, éboulements, crues dévastatrices. Quand la vie de tous dépend du travail de chacun, le reste est secondaire.
Une pensée pour Giovanna, ma grand’mère dont je ne sais, hélas, pratiquement rien, si ce n’est qu’elle était boulangère et fille-mère, donc. Pourquoi n’ai-je pas interrogé mon père pour un peu la connaître ? Je n’ai aucune image d’elle mais je la vois : une petite bonne femme solide, tannée par le soleil d’altitude comme toutes ses copaesane, les paysannes de son village. Elle pétrissait – à la force des bras, quelle femme ! – le pain pour tous et élevait seule son fils. Il est vrai qu’un gamin, dès qu’il tenait solidement sur ses jambes, vivait à l’extérieur de la maison avec les autres gosses, où à l’école, et ne poussait la porte du foyer familial, toujours ouverte, que pour manger et dormir. Manger, c’était bien souvent attraper une tranche de polenta, un morceau de fromage et via, fuori – dehors. Cette femme était fille-mère par amour, à n’en pas douter ; elle n’avait pas pu épouser celui qu’elle aimait. En bonne place dans notre buffet familial était la photo d’un homme, un bel homme, sur lequel planait un mystère. On ne savait rien, ou plutôt on ne disait rien de lui, ni de cette photo gardée précieusement. Pour moi, pas de doute, mon grand’père.
Oui, mais c’est bien sûr ! J’ouvre le passeport de mon père – parvenu par chance jusqu’à moi – établi In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III – et je vois un bel homme, là encore, impeccablement mis, chemise blanche, veste de bonne coupe, nœud papillon, profil d’acteur italien de la grande époque. Pas de ressemblance à proprement parler avec cet homme-mystère, mais le même soin dans la tenue, la même prestance naturelle. Je le réalise au moment où je l’écris : le père et le fils !
Ces deux photos montrent bien que l’un comme l’autre devaient détonner dans ce village. Ils étaient clairement différents, non intégré à cette population industrieuse. Alors, faute de partager leurs travaux, mon père mit sur papier les coutumes et les scènes – les strambalots – qui ont accompagnés son enfance et son adolescence. Ce faisant, il n’a pas utilisé l’italien, la langue officielle et scolastique, mais le furlan, la langue du village, sa langue maternelle comme celle de ma mère – et la mienne par conséquent, langue encore présente et bien vivante (4). Le furlan étant purement oral, mon père en a fait la transcription écrite. Il le fit tardivement. Il avait transporté Sudri en lui lors de son installation en France et le fit renaitre peu à peu dès qu’il en avait le loisir, tâche qui l’a occupé des années durant, à l’aide d’une Remington des premiers temps. Aussi mon enfance a-t-elle été bercée par les cliquetis et les retours-charriot sonores de cette monumentale machine en fonte. Je l’ai conservée ; en dépit de son poids elle m’accompagne dans toutes mes pérégrinations.
Mon père ne travaillait pas aux champs, donc. Quand il ne parcourait pas, en solitaire, i monts – les montagnes – il se construisait, lisait, se cultivait particulièrement dans le domaine linguistique, dans une contrée où confluent les langues du Frioul – autant de langues qu’il y a de vallées, plus l’italien qui s’implantait alors progressivement, l’allemand proche et le français, incontournable en Padanie, l’Italie du Nord (5). Il ne pouvait ignorer non plus la géopolitique, dans cette zone-charnière de l’Histoire – avec un grand H – européenne : au Sud l’empire romain, au Nord la Germanie, à l’Ouest l’Europe occidentale et à l’Est l’Europe centrale.
La géographie commande : c’est dans cette région que durant la guerre de 14 – ici guerre de « 15 » car elle a débuté avec retard – se sont déroulées les grandes batailles de l’Italie, soutenue par France et Grande-Bretagne, contre l’Autriche-Hongrie, soutenue par l’Allemagne. Les Méridionaux, désignés ainsi avec un mépris non dissimulé par ceux du Nord, ont été envoyés, bien que mal préparés, contre une nation guerrière et son armée matériellement et moralement forte, du moins au début du conflit. Mon père, comme les gamins de son âge, ne manquaient pas d’admirer ces formidables machines de guerre, les avions qui les survolaient, indifférents au fait qu’ils allaient semer la mort dans les rangs de leurs compatriotes. Les chansons populaires italiennes racontent le désespoir de ces malheureux expédiés comme du bétail à Gorizia e le terre lontane – les terres lointaines (6). Ces batailles ont été terriblement meurtrières et des noms, comme Caporetto, restent en lettres de sang dans la mémoire italienne.
Puis vint Mussolini. Avec sa chemise blanche, mon père ne pouvait être assimilé aux Camicie nere, les chemises noires des sbires mussoliniens. Curieusement, lui, l’homme des montagnes, se projetait dans la marine, au poste d’officier-radio (7). La Téléphonie Sans Fil de Marconi venait de faire son apparition ce qui permettait, chose incroyable, de converser avec des personnes lointaines. Il avait intégré l’Ecole de Marine de La Spezia. Problème, il ne pouvait lui être délivré de diplôme sans un certificat de « bonne conduite », bonne conduite politique bien entendu. Il devait en faire la demande auprès de sa mairie et l’aurait certainement obtenu s’il avait fait quelque peu allégeance, pour la forme, à ce régime détestable.
Etant trop « droit », précisément, il refusa (heureusement pour nous, ses enfants à naître). Il lui restait l’exil. Un « du pays » l’appela en France, à Jausiers, exactement de l’autre côté de la frontière. C’était l’époque des « Mexicains » ces enfants d’Ubaye partis au Mexique et, fortune faite, revenus se faire construire de belles villas. Profitant habilement de cette manne, mon père mit sur pied une entreprise de maçonnerie prospère et fonda une famille. Mais la guerre intervint pour détruire ce bel édifice et provoquer notre fuite, ce qui n’empêcha pas la faucheuse de faire son œuvre parmi nous.
Plus tard …
« Regardez-le, il sait travailler celui-là, je me demande pourquoi il est allé à l’école ». Je faisais je ne sais plus quoi, de la maçonnerie certainement, comme tout bon fils de maçon, et mon père me regardait avec bienveillance, une bienveillance soigneusement enfouie sous son bleu de travail, comme la fierté que je lui procurais.
Travailler, mon père connaissait. Il connaissait même très bien. Travailler la semaine pour nourrir la famille ; travailler en fin de semaine pour construire la maison familiale ; à la retraite, travailler pour aménager la petite maison qui verra s’écouler ses derniers jours, à l’écart de tout et de tous, proche d’un petit village des Alpes qui ressemble étonnamment au sien, celui où il avait grandi, dans les Alpes lui aussi mais de l’autre côté de la frontière.
Non, loin ni de tout ni de tous. De sa table ou son relax, installés devant sa maison, il dominait la vallée. Rien ni personne ne lui échappait, ni les travaux des champs, ni les animaux menés paître, ou sauvages, ni les promeneurs, ni les trains qui rythmaient sa journée. Les TER de Marseille, aux voitures longues qui se distinguent bien, même de là-haut, de celles, plus courtes, de Grenoble. Et puis le fameux Paris-Briançon, un des rares trains de nuit encore en service. Le matin tôt, il ballote ses passagers enfin endormis, dans une vallée qui s’éveille à peine et le soir il s’étire dans la nuit vers la ville-lumière, en se faufilant sous les lacets du col de Cabre et le long de la charmante et modeste vallée du Diois. Quand et comment a-t-on décidé de creuser ce long tunnel sous la montagne pour que les Parisiens puissent s’ébattre à l’air pur des Alpes ? A bord, ce train offre des services qui fleurent bon un autre temps, comme le dit si bien Philippe Besson (8).
Tous en bas savaient qu’il était là. Je le vis un jour recevoir la visite d’une dame accompagnée de sa fille. Elles se promenaient dans les alentours et avaient profité d’un banc offert pour se reposer un peu et admirer le paysage. En réalité il s’avéra que cet arrêt-détente n’était pas fortuit ; mon père était clairement l’objet de cet pause prétendument inopinée. Il y eut aussi ce prof d’histoire avec qui il fut question de la Triplice – la triple entente Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie signée en 1882, entente sans lendemain. Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres de l’attrait exercé par le «vieux de la montagne».
Non seulement il avait ainsi retrouvé son environnement montagnard, isolé par la neige de Noël à Pâques, mais il avait reconstitué son environnement proche. Il était allé jusqu’à construire un fogolâr de son pays, un foyer placé, au propre comme au figuré, au centre de la vie familiale, sur lequel repose un ensemble de fer forgé destinée à recevoir les ustensiles pour la cuisson des aliments avec, pièce maîtresse, les marmite pour la cuisson de la polenta. On s’y réunissait pour les veillées où circulaient nouvelles et popotins, tandis que grillaient les épis de mais.
Il entretenait une correspondance suivie avec Livia, restée à Sudri. Ils échangeaient des nouvelles qui se répondaient d’un côté à l’autre des Alpes, où la neif – la neige – tenait naturellement une large place. Il ne m’avait jamais parlé de cette correspondance et j’ignorais l’existence de Livia avant que le fils de celle-ci, dont j’avais fait la connaissance de façon inattendue lors d’un passage au pays, ne me l’apprit et me remit les lettres que sa mère avait conservées.
C’est justement dans la neige qu’un jour je peinais à tirer la luge sur laquelle nous avions placé les provisions pour de longues semaines d’hiver et j’appelais à l’aide : pa’ ! pa’ ! mais lui continuait son chemin sans se retourner. Je compris que dès lors l’aide n’irait non plus de lui à moi, mais de moi à lui.
De ce jour pa’ est devenu papa.
- Ariane Ascaride, Bonjour pa’. Editions du Seuil.
- Caroline Bongrand, Ce que nous sommes. Denoël.
- Mon père frappait ma mère, qui ne se révoltait pas, comme c’est généralement le cas. Je l’ai appris par de vieilles lettres découvertes après leur décès. Qu’aurais-je fait si je l’avais su plus tôt ? Comment me comporter face à une personne qui a commis une action odieuse, si de plus cette personne est mon père, mon seul appui ?
- En France, avec mon frère Bruno et ma sœur Wanda nous parlions furlan à la maison et français à l’extérieur, pour ne pas nous faire remarquer.
- Pour draguer sur la plage, me disait un ami de Vérone, j’avais un Sartre sous le bras, en version originale bien entendu, ce qui en dit long à la fois sur l’impact du français et sur l’intérêt des Italiens – et Italiennes – pour la littérature. Anecdote non transposable aux plages françaises !
- Gorizia est une ville-frontière, siège de tous les affrontements ; elle est maintenant coupée en deux, partagée entre Italie et Slovénie.
- Le service militaire a révélé mes dispositions particulières dans ce domaine. Coïncidence, ou bien est-ce la génétique qui parle ?
- Philippe Besson, Paris-Briançon, Julliard.



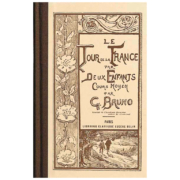





I have to thank you for the efforts youve put in writing this blog. Im hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now 😉
Thanks for the very important information. https://folkd.com/user/chcplayazsite