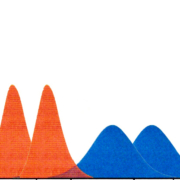J’ai vécu une période de grande errance, sans domicile fixe. En réalité j’en avais un, officiel, à Grenoble où j’allais peu, mais aucun à Marseille, où je vivais. Ce n’était pas par mesure d’économie, même si ce fut une période financièrement difficile, mais plutôt parce j’avais dû laisser celui que j’occupais et je n’avais pas éprouvé le besoin d’en chercher un autre. La recherche d’appartement est une tâche qui me rebute à tel point que je n’ai jamais pu la mener à bien seul.
Je dois dire aussi qu’un logement ne m’était pas alors indispensable. Mon principal lieu de vie était le laboratoire où je travaillais. J’y disposais d’un grand bureau et je pouvais utiliser le coin repas commun, pourvu de tout le nécessaire. Il n’y avait à cette époque aucune limitation à notre temps de travail ; de jour comme de nuit, aucun horaire n’était imposé, au mépris, je dois le reconnaitre maintenant, de toute considération de sécurité. J’étalais un duvet dans mon bureau pour dormir sur place si une expérience se terminait tard, ou même si elle devait se prolonger toute la nuit. Personne ne s’en offusquait ; je n’étais d’ailleurs pas le seul dans ce cas.
Le coin repas comprenait une belle terrasse qui dominait la garrigue. Les soirs d’été, une fois le campus déserté, j’étais seul au monde, avec pour compagnie le Mont Puget qui se laissait complaisamment habiller des voiles irisés du soleil couchant. J’assistais un soir à une scène digne de La Fontaine – né à Château-Thierry, etc…, souvenir de CM2. Maître Renard se promenais nonchalamment, s’amusant à effrayer les criquets qui sautaient sous son nez, quand Ysengrin paru, venu je ne sais d’où. Tous deux avaient bien appris leur leçon : le renard se mit à courir, le chien à ses trousses. Le rusé s’engouffra dans un buisson, pour s’immobiliser à l’intérieur. Le chien, lui, ne fit qu’un bond et traversa l’obstacle, tout penaud de se retrouver seul de l’autre côté. Pendant qu’il s’agitait frénétiquement pour retrouver sa proie, le renard était nonchalamment revenu sur ses pas et s’éloignait sans hâte.
Quelquefois je dormais à l’extérieur, dans ce cadre idyllique. J’étalais mon duvet sous les grands chênes du campus pour éviter la rosée du matin, et dormais baigné des parfums de la garrigue que l’humidité du soir exaltait. A mon réveil, mes yeux étaient à hauteur des herbes sauvages peuplées d’une myriade de minuscules escargots, si nombreux que les tiges en étaient couvertes. Ils s’agitaient la nuit, autant que faire se peut pour un escargot, s’interrompaient au premier rayon de soleil et aussitôt entraient dans leur coquille dont ils colmataient l’ouverture par un rideau de bave durcie, tout en laissant une petite ouverture pour respirer. Dans la journée, ces minuscules coquilles en chapelets le long des herbes paraissent, bien à tort, sans vie. Il faut être là, aux premières lueurs de l’aube pour voir ce monde s’animer.
Lorsque je ne dormais ni au laboratoire ni dans la garrigue, des amis m’hébergeaient quelque temps. Pour le reste, je me laissais totalement aller au bon vouloir d’amies disposées à m’offrir le gite et le couvert. Quand je dis couvert, je pense édredon. J’avais la quarantaine, en rupture de famille, comme souvent à cet âge-charnière. Mes amies étaient sensiblement dans la même situation, ou plus jeunes et encore célibataires. Ces dames étaient toutes d’avis qu’il est difficile de trouver un homme ni névrosé, ni pervers, ni « compliqué », bienveillant surtout et si possible d’un physique avenant (quoique… ) pour passer une nuit agréable. Je répondais au cahier des charges, je n’avais donc que l’embarras du choix. J’ouvrais mon agenda téléphonique en fin de journée et ne tardais pas à trouver un accueil pour la nuit. J’apportais quelques victuailles qui permettaient, avec ce dont disposais mon hôtesse d’un soir, de préparer un repas simple et plaisant, puis nous gagnions la chambre. Tout allait bien même si, les effusions passées, le ciel de lit pouvait se couvrir et l’ambiance devenir orageuse, avec pour effet de me retrouver à la rue à deux heures du matin – heure critique. Ce n’était pas grave, mon duvet m’attendait.
C’est ainsi qu’il m’arriva de passer un certain nombre de nuits avec autant d’amies différentes. Ce ne fut pas prémédité, seulement le fruit du hasard.
Il se produisit alors quelque chose d’étrange. Après quelques jours, ou plutôt quelques nuits, celles qui se succédaient dans mes bras devinrent peu à peu floues, s’estompèrent et, dans mon demi-sommeil, se mêlèrent les unes aux autres. Alors que chacune aurait dû être pour moi un renouvellement, m’apporter un lot de sensations nouvelles, je ressentis progressivement une surprenante monotonie. Etonnamment, ma perception se ramena bientôt à ce qu’elles toutes avaient en commun, autrement dit j’eus rapidement l’étrange impression de dormir avec, disons-le crûment, une paire de seins et une paire de fesses.
C’est un phénomène que les physiciens connaissent bien, dans leur domaine. Lorsqu’on enregistre une expérience, dans un premier temps l’appareil ne génère qu’un tracé plus ou moins irrégulier, dû à toutes sortes de perturbations minimes, ce que dans notre jargon appelons une « ligne de base ». Quand une réaction se produit, le tracé dessine une bosse, plus ou moins haute, plus ou moins fine et pointue, selon l’intensité du signal reçu par l’appareil ; c’est « un pic ». Si le signal est trop faible, le pic se confond avec les irrégularités du tracé et passe inaperçu. L’expérience est alors répétée, dans les mêmes conditions. D’une répétition à l’autre, les fluctuations de la ligne de base, qui ne se produisent jamais à l’identique, finissent par s’annuler, alors que le petit pic, qui lui revient toujours à la même place, apparait et grandit progressivement.
J’étais dans la situation où je ne percevais plus très bien ce qui changeait d’une nuit à l’autre, par contre j’avais pleine conscience de ce qui se répétait régulièrement ; je ne percevais plus distinctement que deux pics, ou plus exactement deux doubles pics.
A la réflexion je me dis que ce n’est pas extraordinaire. Avec chacune de ces dames je ne passais que le temps d’un repas, généralement l’occasion de propos assez banals, le plus souvent l’échange de nouvelles de la vie de tous les jours, l’évocation des uns et des autres. La situation ne se prêtait pas à des discussions approfondies. Ensuite, le contact rapproché et sans paroles, sous un éclairage atténué, n’est pas le meilleur moyen de mettre en lumière les individualités.
Je pense aux grands séducteurs qui multiplient les conquêtes féminines. Il y a les conquistadors, les collectionneurs, ceux qui tiennent un livre d’or [Patachou, La Chose], ceux à la recherche de sensations nouvelles. Ils vont au-devant d’une cruelle déception. Changer de compagne après une longue fréquentation, c’est changer d’univers. Par contre, plus on change, plus c’est la même chose.